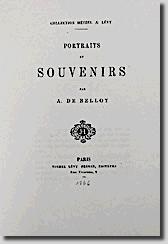LE REGARD DES AUTRES
AUGUSTE DE BELLOY (1815-1871)
Le marquis Auguste de Belloy publie en 1866 Portraits et Souvenirs. Le chapitre 3 est consacré à l’histoire du café Valois, au Palais Royal à Paris, devenu sous la Restauration le lieu de réunion de la noblesse d’ancien régime, vieillie, mais pleine de souvenirs, tandis qu’au café Lemblin, rival du café Valois, se retrouvaient plutôt des officiers en demi-solde de l’Empire, républicains et libéraux. Nerval n’a pu qu’être séduit par cette atmosphère XVIIIe siècle du café Valois, par les tenues vestimentaires comme par les anecdotes qui s’y racontaient, et la « bavaroise » que l’on y consommait. En 1825, il restait très peu de figures de l’ancien régime, mais la jeune génération était là, ayant fondé le club très fermé des « ganaches », sorte de nouvelle version de la Table ronde, dont Belloy obtint le brevet en 1834. On fut peu sensible au café Valois à la révolution de 1830. On préférait y écouter ressasser les hauts faits d’autrefois par les rares survivants, dont le comte d’Harambure et le marquis de Rivarol, qui avait connu Voltaire, échappé de peu à la guillotine, mais n’en était pas moins bizarrement épris de romantisme, et se piquait de littérature. Il voulait publier un recueil de poésies, et c’est Nerval, qui fréquentait alors le café Valois, qui suggéra un titre : Margaritas (à noter que Balzac donne en 1835 le titre des Marguerites au recueil de poèmes de Lucien de Rubempré dans Illusions perdues). L’ouvrage faillit bien être publié chez Ladvocat.
******
C’est au chapitre 9, intitulé « Les piliers du café Valois », que Nerval entre en scène :
Gérard de Nerval était au meilleur point de sa vie et de sa carrière à l’époque où on put le voir fréquenter le café Valois. Une série d’articles fort remarqués dans une revue influente l’avaient tout récemment mis en pleine lumière. Jouissant à la fois des premières faveurs de la gloire et de celles de la fortune, il se hâtait, sans bruit, sans étalage, en véritable homme de goût, d’épuiser cette double chance ; devinant trop bien que l’embellie serait passagère, il mangeait, comme on dit, son blé en herbe et ses lauriers en herbe. Ses chefs-d’œuvre, en effet, écrits dans sa maturité, sont d’un art bien plus achevé que les Amours de Vienne ; mais il venait dans ces esquisses de donner sa note, sa vraie, sa seule note, et on lui tenait compte de ce qu’elle avait de personnel et d’imprévu, sinon encore de parfait [...]
A quiconque l’a vu sans suite, et à la plupart de ceux qui ont vécu dans sa société habituelle, Gérard de Nerval a laissé pour souvenir quelque chose de doux et de léger comme un parfum. Je ne parle pas de sa probité, de son désintéressement, ni même de sa délicatesse, la moindre de ses qualités sociales : exquis en tout, rien n’égalait la douceur de son caractère, la grâce, la distinction, l’ornement choisi mais singulier de son esprit ; sa bienveillance un peu trop égale ; sa modestie, ou plutôt son silence sur sa personne, sur ses ouvrages ; la sûreté de ses rapports, sûreté telle, que, dans sa folie même, il ne lui échappa jamais un mot compromettant pour qui que ce fût au monde ; et il connaissait bien du monde !
Laborieux, serviable, utile même dans la mesure de ses forces, aimable surtout, ses amis, ses confrères, ses contemporains, la société en un mot, n’ont eu à lui reprocher que sa mort, si toutefois il se l’est donnée, comme je le crains, dans le moment le plus lucide qu’il ait eu dans toute sa vie.
Pour moi, cela ne fait aucun doute, Gérard avait rêvé un rôle littéraire plus éclatant que celui q’il lui fut donné de remplir. Ses excursions dans le drame n’ont pas eu pour mobile unique, dans les commencements surtout, le désir légitime d’améliorer sa fortune ; s’il est vrai qu’il écrivit le libretto de Piquillo en vue de se rapprocher d’une cantatrice aussi aimable que légère, il ne l’est pas moins, à mon sens, qu’avec ce beau drame de Léo Burckart il compta prendre rang parmi les royautés plus ou moins légitimes du théâtre français moderne.
Là, comme auprès de la belle Jenny Colon, il n’obtint qu’un succès d’estime : la popularité le dédaigna comme trop littéraire ; la comédienne était allée plus loin : elle avait daigné lui offrir sa main. « Vous me comblez », dit Gérard en se retirant.
Une telle offre dépassait, en effet, ses espérances, jusqu’à ne lui en laisser aucune.
De ce double coup, il resta mortellement atteint dans son cœur et dans son esprit. Telle est, du moins, l’impression que m’ont laissée des relations intermittentes, mais très intimes avec lui. Ce qui pourra ôter quelque crédit à cette opinion auprès de la plupart de ceux qui ont connu superficiellement Gérard de Nerval, c’est l’extraordinaire indulgence qu’il montrait à l’égard des écrivains contemporains les moins goûtés de leurs confrères. Parmi ceux mêmes qui l’ont vu avec suite et étudié avec intérêt, le plus petit nombre, j’imagine, a dû pénétrer quels profonds dédains recouvrait cette bienveillance imperturbable.
Un même mélange de hauteur, de prudence et de politesse l’empêchait de parler de lui ; sa plume heureusement était moins retenue sur ce chapitre intéressant ; mais il était si maître de sa plume ! Il savait si bien, dans un livre, se sacrifier, s’immoler avec tous les honneurs de la guerre ! Au temps où il eut à lutter contre les nécessités les plus infimes, les plus cruelles de la vie, son abord souriant, sa conversation toujours enjouée, jamais distraite, n’en laissait rien transpirer au dehors.
Dans les dernières années de sa vie, lorsque sa pauvreté éclatait malgré lui dans l’insuffisance et l’étrangeté de son costume, il savait encore donner à ces apparences navrantes la couleur du caprice ou de la négligence ; non pas qu’il rougît de sa pauvreté : loin de là, il en était fier, et à bon droit ; mais parce qu’il n’ignorait point qu’un homme d’esprit et bien né ne se plaint jamais du sort, ni des hommes, ni des femmes bien entendu, trois choses identiques ou qui se valent tout au moins.
— Auguste de Belloy en vient ensuite au souvenir précis de Nerval au café Valois ; l’anecdote du cyclophore (prêtée à Nodier par Asselineau) :
Gérard de Nerval ne se mêla point d’abord à la société toute spéciale qui faisait le fond du café Valois. On ne le voyait point le soir, mais bien entre onze heures et midi, prenant, seul et plongé dans la lecture des revues, un déjeuner simple mais fin. Les seuls habitués qu’il parût connaître étaient Soulié, non pas le romancier fécond dont la seule vue l’eût fait fuir, — mais le journaliste, aujourd’hui oublié, que l’on appelait le vieux Soulié de la Quotidienne ; Merle, dont l’esprit charmant et les manières distinguées l’avaient d’abord attiré au café Valois, et, enfin, un jeune employé que je nommerai seulement Robert, pour des raisons qu’on approuvera, j’en suis sûr.
C’est à ce dernier que je dus la fête d’être présenté à Gérard de Nerval, auprès de qui je déjeunais depuis six mois, mourant d’envie de le connaître, mais dissimulant cette envie avec toute la morgue d’une jeunesse très timide. Il se livra plus promptement que je ne l’aurais espéré ; et, du premier jour, je fus tout à lui, quoique un peu humilié de me voir à un tel degré dépassé dans ce qu’aujourd’hui j’ose appeler le paradoxe. On en jugera par un trait.
La conversation était tombée, je ne sais plus comment, sur l’entomologie. Gérard, comme de juste, en avait une à lui. Il ne tarissait pas sur la merveilleuse structure et les talents non moins merveilleux de ces petits industriels, types inconscients de nos métiers et de nos arts ; il en nommait et en décrivait de prodigieux, dont je n’avais jamais ouï parler, et que, je dois le dire, je n’ai trouvé depuis dans aucune nomenclature.
— Eh bien, monsieur, dit-il enfin, ce même cyclophore, qui offre réunis dans une de ses trompes tous les instruments du tourneur, et dans l’autre ceux du lampiste, j’en ai fait un, moi qui vous parle, et vous ne devineriez jamais avec quoi : avec mes doigts, tout simplement.
— Mais la matière, dit Robert prenant la chose au sérieux avec sa simplicité ordinaire.
— La matière ? Oh ! mon Dieu ! rien qu’un peu de peluche prise au fond d’une de mes poches. Oui, monsieur, poursuivit-il en me regardant fixement, et je l’ai fait en moins de dix minutes, sur le boulevard, en causant avec Méry, qui l’a vu et vous le dira.
Je m’inclinai devant ce témoignage.
— Et qu’est-il devenu ? s’écria l’innocent Robert.
— Ce qu’il est devenu ? Je le portais à Geoffroy Saint-Hilaire, quand tout à coup il s’envola. Et, depuis, je n’ai jamais pu en refaire un autre.
L’idée de la folie était si loin de moi, que je vis là une simple boutade, dont je ris de bon cœur, au grand scandale de Robert. Gérard n’en parut nullement blessé. Sa conversation, une vraie pluie d’étoiles, bien que les météores de cette force n’y fussent que très clairsemés, aurait dû m’alarmer pourtant ; mais la jeunesse de l’époque était montée à un tel diapason, et les vieillards que j’avais fréquentés étaient eux-mêmes si exaltés en sens inverse, que Gérard me parut en somme plus raisonnable sur beaucoup d’autres, et amusant comme pas un.
— L’érudition de Nerval, sa passion pour « les bizarreries historiques et littéraires » :
Son érudition était aussi vaste qu’étrange ; indigeste, dirait un cuistre ; rare est le terme le plus séant. Nul homme n’avait mis aussi bien que lui en pratique ce conseil d’un ministre qui engageait ses publicistes à ne jamais développer que le côté inutile des questions.
La prodigieuse mémoire de Gérard de Nerval était un répertoire, je suis loin de dire complet, mais à coup sûr immense, des singularités humaines, et principalement des bizarreries historiques et littéraires.
S’il ignorait le nom de la plupart des souverains du monde civilisé, il possédait en revanche sur le bout du doigt, tout arbre généalogique de prétendant actuel du royaume d’Abyssinie, dont la lignée remonte aux amours légitimes de Salomon et de Madeka, reine de Saba. La cause de ce jeune prince détrôné, je crois, par son frère, avait en Gérard de Nerval un avocat aussi passionné que disert. Assez peu royaliste en France, il était ultra en Abyssinie.
Les pays lointains, les plus reculés, antéhistoriques, l’attiraient par d’irrésistibles appels ; il possédait toutes les données problématiques et, le plus souvent, imaginaires, qui ont eu cours, en divers temps, sur les origines humaines. Ces hypothèses, pour la plupart orientales, avaient pour lui une authenticité qu’il déniait parfois, non sans raison, à l’histoire proprement dite. Ainsi, pour lui, Charlemagne n’était qu’un mythe ; il ne parlait qu’en souriant du docte maître d’Alexandre ; mais Samboscer, le précepteur d’Adam, figurait souvent dans ses causeries comme un personnage réel. Les Décades perdues de Tite-Live, les Commentaires également perdus de Sylla, tout ce qui nous manque en un mot des auteurs anciens, lui paraissait peu regrettable ; mais il ne se consolait pas de la perte du livre des livres, le fameux Abistek, reçu directement du ciel par Abraham.
Les hérésiarques, les thaumaturges, les visionnaires et utopistes de toute sorte lui inspiraient une sympathie curieuse, mais en raison surtout de leur antiquité. Il apprenait avec étonnement que vous n’aviez jamais lu Origène ni Apollonius de Tyanes ; que vous n’étiez pas en état de faire la distinction d’Hillel l’Ancien et d’Hillel le Saint ; que vous ignoriez jusqu’au nom d’Asclépiodote ou de Wigbode [...]
— Chapitre 10 : comment Nerval fut adopté par cette société d’Ancien Régime qui vivait encore dans un autre siècle, et se laissa séduire par elle, dans le consentement lucide et réciproque à la douce folie de l’autre :
Si j’ai pu donner une idée approximative de la société habituelle du café Valois, on se figurera aisément l’effet que dut y produire Gérard de Nerval, quand je fus parvenu à rompre la glace entre lui et mes vieux amis. Ses formes polies, sa mesure parfaite dans la discussion, son imperturbable sérénité, écartaient le soupçon qu’il pût se moquer de son auditoire ; restait la question de folie, que chacun eut bientôt résolue in petto, et qui arrangea tout à la satisfaction générale.
Du jour où il fut prouvé pour Gérard qu’il avait affaire à des gens fort aimables, mais complètement privés de raison, et où ceux-ci, de leur côté, n’eurent plus aucun doute sur l’insanité mentale de Gérard, ce fut entre eux comme un assaut d’égards et de concessions réciproques. Les rapports devinrent charmants. Lorsque Gérard enfourchait un de ses dadas, le comte d’Harambure me poussait bien un peu le coude en tapinois ; mais il gardait un sérieux auquel Gérard se laissait prendre, et de même, quand le comte entamait le récit de ses guerres de l’Inde ou l’exposition de sa généalogie, Gérard, en me marchant doucement sur le pied, n’en écoutait pas moins le comte avec son sourire attentif [...]