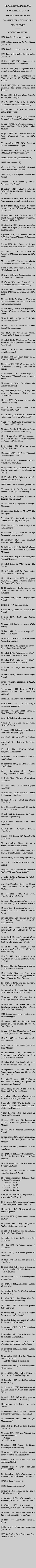
28 juin 1840 — Lettres de voyage. De Paris à Vienne. Un jour à Munich, IV, dans La Presse, rubrique « Variétés », signée Fritz.
La rubrique « Variétés » de La Presse s’ouvre sur la notice suivante, qui montre combien Nerval tente d’exploiter un genre littéraire à la mode : « Les chambres sont closes de fait, sinon officiellement ; c’est le moment des voyages : les Lettres sur l’Allemagne seront suivies de lettres sur l’Espagne, par M. Théophile Gautier ; de lettres sur la Louisiane, par M. Frédéric Gaillardet ; de lettres sur quelques châteaux de France, par Mme Charlotte de Sor, etc. »
La « lettre » sur Munich sera reprise le 9 novembre 1845 dans L’Artiste-Revue de Paris, 4e série, t. V, p. 25-28, sous le titre : Physionomie des villes d’Europe. Munich, signée Gérard de Nerval (sans les deux derniers paragraphes), puis en 1849 dans Al Kahira. Souvenirs d’Orient, La Silhouette, 21 janvier, et enfin en 1851 au chapitre V, « Un Jour à Munich », de l’Introduction du Voyage en Orient.
Nerval n’est pas tendre pour la capitale du jeune royaume de Bavière que Louis 1er est en train d’édifier. Après avoir parcouru au pas de charge les nouveaux bâtiments des musées construits dans le goût antique, il conclut : « On est fatigué de ces édifices battant-neufs, d’une architecture si grecque, égayés de peintures antiques si fraîches. »
Voir la notice UN HIVER À VIENNE.
******
LETTRES DE VOYAGE.
IV.
DE PARIS À VIENNE — UN JOUR À MUNICH.
À une époque où l’on voyageait fort peu, faute de bateaux à vapeur, de chemins de fer, de chemins ferrés et même de simples chemins, il y eut des littérateurs, tels que d’Assoucy, Lepays et Cyrano de Bergerac, qui mirent à la mode les voyages dits fabuleux. Ces touristes hardis décrivaient la lune, le soleil et les planètes, et procédaient du reste dans ces inventions de Lucien, de Merlin-Coccaïe et de Rabelais. Je me souviens d’avoir lu dans un de ces auteurs, la description d’une étoile qui était toute peuplée de poètes ; en ce pays-là la monnaie courante était de vers bien frappés ; on dînait d’une ode, on soupait d’un sonnet ; ceux qui avaient en portefeuille un poème épique pouvaient traiter d’une vaste propriété.
Un autre pays de ce genre était habité seulement par des peintres, tout s’y gouvernait à leur guise, et les écoles diverses se livraient parfois des batailles rangées. Bien plus, tous les types créés par les grands artistes de la terre avaient là une existence matérielle, et l’on pouvait s’entretenir avec la Judith de Caravage, le Magicien d’Albert Durer ou la Madeleine de Rubens.
En entrant à Munich, on se croirait transporté tout à coup dans cette étoile extravagante. Le roi-poète qui y réside aurait pu tout aussi bien réaliser l’autre rêve, et enrichir à jamais ses confrères en Apollon ; mais il n’aime que les peintres ; eux seuls ont le privilège de battre monnaie sur leur palette ; le rapin fleurit dans cette capitale, qu’il proclame l’Athènes moderne, mais le poète s’en détourne et lui jette en partant la malédiction de Minerve ; il n’y a là rien pour lui.
En descendant de voiture, en sortant du vaste bâtiment de la Poste-Royale, on se trouve en face du palais, sur la plus belle place de la ville ; il faut tirer vite sa lorgnette et son livret, car déjà le musée commence, les peintures couvrent les murailles, tout resplendit et papilotte [sic], en plein air, en plein soleil.
Le palais neuf est bâti exactement sur le modèle du palais Pitti, de Florence ; le théâtre, d’après l’Odéon de Rome ; l’hôtel des postes, sur quelque autre patron classique ; le tout badigeonné de haut en bas de rouge, de vert et de bleu-ciel. Cette place ressemble à ces décorations impossibles que les théâtres hazardent quelquefois ; un solide monument de cuivre rouge établi au centre, et représentant le roi Maximilien Ier, vient seul contrarier cette illusion. La poste, toute peinte d’un rouge sang de bœuf, qualifié de rouge antique, sur lequel se détachent des colonnes jaunes, est égayée de quelques fresques dans le style de Pompéïa, représentant des sujets équestres. L’Odéon expose à son fronton une fresque immense où dominent des tons bleus et roses, et qui rappelle nos paravens d’il y a quinze ans ; quant aux palais de roi, il est uniformément peint d’un beau vert tendre. Le quatrième côté de la place est occupé par des maisons de diverses nuances. En suivant la rue qu’elles indiquent, et qui s’élargit plus loin, on longe une seconde face du palais plus ancienne et plus belle que l’autre, où deux portes immenses sont décorées de statues et de trophées de bronze d’un goût maniéré mais grandiose. Ensuite, la rue s’élargit encore ; des clochers et des tours gracieuses se dessinent dans le lointain ; à gauche s’étend à perte de vue une file de palais modernes propres à satisfaire les admirateurs de notre rue de Rivoli ; à droite, un vaste bâtiment dépendant du palais, qui du côté de la rue est garni de boutiques brillantes, et qui forme galerie du côté des jardins, qu’elle encadre presque entièrement. Tout cela a la prétention de ressembler à nos galeries du Palais-Royal ; les cafés, les marchandes de modes, les bijoutiers, les librairies sont à l’instar de Paris. Mais une longue suite de fresques représentant les fastes héroïques de la Bavière entremêlées de vues d’Italie témoignent d’arcade en arcade, de la passion du roi Louis pour la peinture, et pour toute peinture à ce qu’il paraît. Ces fresques, le livret l’avoue, sont traitées par de simples élèves. C’est une économie de toiles ; les murs souffrent tout.
Le Jardin royal, entouré de ces galeries instructives, est planté en quinconce et d’une médiocre étendue ; la face du palais qui donne de ce côté, et où les ouvriers travaillent encore, présente une colonnade assez imposante ; en faisant le tour par le jardin, on rencontre une autre façade composée de bâtimens irréguliers, et dont fait partie la basilique, le mieux réussi des monumens modernes de Munich.
Cette jolie église, fort petite d’ailleurs, est un véritable bijou ; construite sur un modèle byzantin, elle étincelle, à l’intérieur, de peintures à fonds d’or, exécutées dans le même style. C’est un ensemble merveilleux de tout point ; ce qui n’est pas or ou peinture est marbre ou bois précieux ; le visiteur seul fait tache dans un intérieur si splendide, auquel on ne peut comparer dans toute l’Europe, que la chapelle des Médicis à Florence.
En sortant de la basilique, nous n’avons plus que quelques pas à faire pour rencontrer de nouveau le théâtre ; car nous venons de faire le tour du palais, auquel se rattachent tous ces édifices comme dépendances immédiates. Pourquoi n’entrerions-nous pas dans cette vaste résidence ? Justement le roi va se mettre à table, et c’est l’heure où les visiteurs sont admis, dans les salles où il n’est pas, bien entendu.
On nous reçoit d’abord dans la salle des gardes, toute garnie de hallebardes, mais gardée seulement par deux factionnaires et autant d’huissiers. Cette salle est peinte en grisailles figurant des bas-reliefs, des colonnes et des statues absentes, selon les procédés surprenans et économiques de M. Abel de Pujol. Assis sur une banquette d’attente, nous assistons aux allées et venues des officiers et des courtisans. Et ce sont en effet de véritables courtisans de comédie, par l’extérieur du moins. Quand M. Scribe nous montre, à l’Opéra-Comique, des intérieurs de cours allemandes, les costumes et les tournures de ses comparses sont beaucoup plus exacts qu’on ne croit. Une dame du palais, qui passait avec un béret surmonté d’un oiseau de paradis, une collerette ébouriffante, une robe à queue et des diamans jaunes, m’a tout à fait rappelé Mme Boulanger. Des chambellans chamarrés d’ordres semblaient prêts à se faire entendre sur quelque ritournelle d’Auber.
Enfin, le service du roi a passé, escorté par deux gardes. C’est alors que nous avons pu pénétrer dans les autres salles. Je plains fort le roi de ce pays, qui se défend pourtant d’être un monarque constitutionnel, de s’être imposé l’usage d’admettre deux fois par jour une trentaine de personnes dans l’intérieur de son domicile. En sortant de table, il retrouve ses parquets et ses meubles souillées d’empreintes inconnues ; ce qu’il touche vient d’être touché ; l’air est encore plein d’haleines impures ; des Anglais ont gravé furtivement leurs noms sur les glaces et sur les marbres des consoles. Qui sait ce qu’on a pris, et qui sait ce qu’on a laissé ? Cela me rappelle qu’un jour on m’a fait voir, à Trianon, le lavabo du duc de Nemours à côté de celui de Joséphine, et un petit morceau de savon dont le prince s’était servi la dernière fois qu’il y avait couché.
Je m’abstiendrai de décrire en détail l’intérieur du palais de Munich, dont tous les guides de voyageurs ont énuméré les richesses artistiques. Ce qu’il faut le plus remarquer, c’est la salle décorée de fresques de Schnorr sur les dessins de Cornélius, dont les sujets sont empruntés à la grande épopée germanique des Nibelungen. Ces peintures, admirablement composées, sont d’une exécution lourde et criarde, et l’œil a peine à en saisir l’harmonie ; de plus, les plafonds, chargés de figures gigantesques et furibondes, écrasent leurs salles mesquines et médiocrement décorées ; il semble partout à Munich que la peinture ne coûte rien ; mais le marbre, la pierre et l’or sont épargnés davantage. Ainsi ce palais superbe est construit en briques, auxquelles le plâtre et le badigeon donnent l’aspect d’une pierre dure et rudement taillée ; ces murailles éclatantes, ces colonnes de portore et de marbre de Sienne, approchez-vous, frappez-les du doigt, c’est du stuc. Quant au mobilier, il est du goût le plus empire que je connaisse, les glaces sont rares, les lustres et les candélabres semblent appartenir au matériel d’un Cercle d’un Casino de province ; les richesses sont au plafond ; c’est encore un rêve, où le roi-poète peut poursuivre en passant les magnificences de l’Olympe ou les vagues splendeurs du Walhalla.
Je suis loin de vouloir rabaisser les beautés de cette résidence, et le goût du roi de Bavière pour les arts plastiques n’a pas de quoi donner prise au ridicule ; mais je me demande s’il est bien vrai que M. Cornélius, lorsqu’il vint à Paris l’an passé, n’ait pas été émerveillé des richesses de Versailles et qu’il ait à peu près parlé comme le Gascon, qui trouvait que le Louvre ressemblait aux écuries du château de son père ; nous le croyons un homme de trop de goût et de bonne foi pour que cette histoire soit vraie, d’autant plus que si le palais de Munich a quelques beautés incontestables, c’est un point où le talent de M. Cornélius est presque seul intéressé, et à nous seuls aussi il appartient de lui en rapporter la gloire.
Le repas du roi étant fini, nous pouvons commencer le nôtre ; il n’y a qu’un seul restaurateur dans la ville, qui est un Français, autrement il faut prendre garde aux heures des tables d’hôte. La cuisine est assez bonne à Munich, la viande a bon goût ; c’est là une remarque plus importante qu’on ne croit, en pays étranger. On ne sait pas assez que la moitié de l’Europe est privée de beefsteaks et de côtelettes passables, et que le veau domine dans certaines contrées avec une déplorable uniformité. Songez-vous, Parisiens ! que l’Espagne et l’Italie manquent de beurre absolument. Peut-être n'avez-vous jamais fait grande attention à l’humble ingrédient qu’on appelle du beurre. Hé bien ! quand le bateau à vapeur qui vient de Naples touche à Nice, la première idée des passagers est de courir au café-royal sur la grande place et d’y déjeuner avidement avec du beurre et du lait. Du lait ! et savez-vous comment les dames italiennes font leur café du matin ? Ces infortunées délayent des blancs d’œuf dans du café noir faute de lait, et elles boivent ce mélange. Voilà ce qu’on ne sait pas !
Munich manque d’huîtres et de poissons de mer naturellement ; ses vins sont médiocres et chers, mais elle vante sa bierre, qui en effet a une grande réputation dans toute l’Allemagne. Il ne faut pas parler de la bierre du Munich à des voyageurs qui ont bu des bierres belges et anglaises. Le faro, l’ale et le lambick sont des bierres dont on n’a pas d’idée même à Paris ; ce sont de véritables vins du nord, qui égaient et grisent plus vite que le vin lui-même. Les bierres impériales et royales d’Autriche et de Bavière n’ont aucun rapport avec ces nobles boissons. Aussi disputent-elles au tabac le privilège d’engourdir et d’assoupir de plus en plus ce grand corps du peuple allemand.
Le lecteur me pardonnera ce hors-d’œuvre culinaire qui n’est pas hors de propos, car les voyageurs ont faim comme les héros, et la nourriture est une impression de voyage incontestable. Les deux cafés de la Galerie-Royale ne sont pas fort brillans, et n’ont aucun journal français. Un vaste cabinet de lecture et une sorte de Casino, qu’on appelle le Musée, contiennent en revanche la plupart des feuilles françaises que la censure laisse entrer librement. De temps en temps, il est vrai, quelque numéro manque, et les abonnés lisent à la place cet avis : que le journal a été saisi, à Paris, à la poste et dans les bureaux. Cela se répète si souvent même à l’égard du Journal des Débats que nous soupçonnons le parquet de Munich de calomnier celui de Paris. Il résulte encore de ce subterfuge que les braves Munichois ont des doutes continuels sur la tranquillité de notre capitale ; la leur est si paisible, si gaie et si ouverte, qu’ils ne comprennent pas les agitations les plus simples de notre vie politique et civile ; la population ne fait aucun bruit, les voitures roulent sourdement sur la chaussée poudreuse et non pavée. Le Français se reconnaît partout à ce qu’il déclame ou chantonne en marchant ; au café il parle haut ; il oublie de se découvrir au théâtre ; même en dormant, il remue sans cesse, et un lit allemand n’y résiste pas dix minutes. Imaginez-vous des draps grands comme des serviettes, une couverture qu’on ne peut border, un édredon massif qui pose en équilibre sur le dormeur ; eh bien ! l’Allemand se couche et tout cela reste sur lui jusqu’au lendemain ; de plus, connaissant sa sagesse, on lui accorde des oreillers charmans, brodés à l’entour et découpés en dentelles sur un fond de soie rouge ou verte ; les plus pauvres lits d’auberge resplendissent de ce luxe innocent.
Puisque nous parlons des oreillers, parlons tout de suite des poêles. Les poêles bavarois sont les plus beaux de monde ; leur construction est de l’architecture, et leurs ornemens sont de la sculpture en réalité. Si l’on connaissait bien à Paris les poêles allemands, on ne voudrait plus de cheminées. C’est la plus belle pièce d’un mobilier. Cela convient à une chambre comme à une salle de palais. J’ai vu un poêle allemand au château de Rastadt, enrichi il est vrai de peintures et de porcelaines, qu’on estimait cent mille florins. Les plus beaux de ces monumens disparaissent peu à peu de l’Allemagne, car les princes et les grands seigneurs adoptent presque partout la cheminée française ; mais la bourgeoisie tient toujours pour ses vieux poêles et elle a raison.
Je sens bien que le lecteur est pressé de faire connaissance avec la Glyptothèque et la Pinacothèque ; mais ces musées sont fort loin du centre de la ville, et il faut le temps d’y arriver. Dans sa pensée d’agrandissement indéfini pour sa capitale, le roi Louis a eu soin de construire à de grandes distances les uns des autres ses principaux monumens, ceux du moins autour desquels on espère que les maisons viendront un jour se grouper. La ville de Munich était naturellement une fort petite ville, de la grandeur d’Augsbourg tout au plus : la lyre du roi-poète en a élevé les murailles et les édifices superbes. Il eût, comme Amphion, fait mouvoir les pierres à ce grand travail, mais il n’y avait pas de pierres dans tout le pays. C’est là le grand malheur de cette capitale improvisée d’un royaume encore si jeune ; delà la brique rechampie, delà le stuc et le carton-pierre, delà des rues boueuses ou poudreuses selon la saison ; le grès manque, et l’autorité hésite entre divers projets soumis par les compagnies de bitume ; le Polonceau est séduisant, le Seyssel a plus de crédit, le Roux se recommande aux artistes, la ville hésite devant la dépense, et Munich n’est encore pavée, comme l’enfer, que de bonnes intentions.
Après bien des places indiquées à peine, bien des rues seulement tracées et où l’on donne des terrains gratuits, comme dans les déserts de l’Amérique, à ceux qui veulent y bâtir, on arrive à la Gliptothèque [sic], c’est-à-dire au musée des statues ; on est tellement grec à Munich, que l’on doit être bien bavarois à Athènes ; c’est du moins ce dont se plaignent les Grecs véritables. Le bâtiment est tellement antique dans ses proportions, que les marches qui conduisent à l’entrée ne pourraient être escaladées que par des Titans : un petit escalier dans un coin répare cet inconvénient, que nous nous garderons d’appeler un vice de construction. À l’intérieur, les salles sont vastes et pratiquées dans toute la hauteur du monument. Elles sont enduites partout de cette teinture de garance foncée, que les livrets continuent à garantir vrai rouge antique. Les ornemens qui s’en détachent sont toujours de ce style Pompéïa, sur lequel nous avons été blasés par nos cafés, nos passages, et par les décorations du Gymnase. On a donc le droit de récuser notre mauvais goût parisien, surtout lorsqu’on a soin de faire remarquer (dans ce livret autorisé et censuré,) que le roi de Bavière, dans la décoration de ses palais et de ses musées, s’est toujours éloigné du faux goût qui florissait dans les 17e et 18e siècles. Ceci nous paraît encore dirigé contre Versailles, et plusieurs allusions que nous n’avons plus sous la main, nous confirment dans cette pensée.
Les peintres se sont livrés sur les plafonds de la Glyptothèque à des intempérances de couleur que nous sommes loin d’approuver. Les magnifiques bas-reliefs de Phidias, le Silène, et les marbres purs de Canova, qu’on rencontre en baissant les yeux, eussent dû faire honte aux prétentieuses compositions des peintres germaniques. Nous exceptons toujours celles de M. Cornélius, qui ne sont en effet que des compositions, puisqu’elles ne sont pas peintes par lui. Il a décoré tout une salle avec des sujets tirés de l’Iliade, dont on a pu voir les dessins à Paris. Je n’ai pas besoin de répéter ce que tout le monde sait aujourd’hui, que les dessins envoyés ici comme copies des fresques de l’école de Munich ne donnent qu’une idée très fausse de l’effet des peintures originales ; il n’est pas de voyageur qui n’ait fait cette observation.
La Glyptot[h]èque renferme une collection d’antiques fort précieuse et des chefs-d’œuvre de Canova, parmi lesquels se trouvent La Frileuse, la Vénus-Borghèse, un buste de Napoléon et un autre du prince Eugène. Quelques statues du trop célèbre Thorwaldsen partagent avec celles de Canova les honneurs d’une salle particulière, où leurs noms sont accolés à ceux de Phidias et de Michel-Ange. On ignore probablement à Munich les noms français de Puget et de Jean Goujon.
La Pinacothèque, c’est-à-dire le musée de peinture, est située à peu de distance de la Glyptothèque. Son extérieur est beaucoup plus imposant, quoique le style grec en soit moins pur. Ces deux édifices sont d’un architecte nommé Léon de Glenze. Ici, nous n’aurons plus qu’à louer ; les salles sont grandes, et ne sont ornées que de peintures de maîtres anciens. Une galerie extérieure, qui n’est pas ouverte encore au public, est toutefois fort gracieusement peinte et décorée, et l’ornement antique y est compris à la manière italienne avec beaucoup de richesse et de légèreté. Il serait trop long d’énumérer tous les chefs-d’œuvre que renferme la Pinacothèque. Qu’il suffise de dire que la principale galerie renferme une soixantaine de Rubens choisis et des plus grandes toiles. C’est là que se trouve Le Jugement dernier de ce maître, pour lequel il a fallu exhausser le plafond de dix pieds. Là aussi se rencontre aussi l’original de La Bataille des Amazones, que notre collaborateur Théophile Gautier a décrite d’après la gravure avec tant de verve et d’éclat. Après avoir parcouru les grandes salles consacrées aux grands tableaux, on revient par une suite de petites salles divisées de même par écoles, et où sont placées les petites toiles. Cette intelligente disposition est très favorable à l’effet des tableaux.
Que reste-t-il à voir encore dans la ville ? On est fatigué de ces édifices battant-neufs, d’une architecture si grecque, égayés de peintures antiques si fraîches. Il y aurait encore pour tout Anglais à admirer six ministères avec ou sans colonnes, une maison d’éducation pour les filles nobles, la bibliothèque, plusieurs hospices ou casernes, une église romane, une autre bysantine [sic], une autre renaissance, une autre gothique. Cette dernière est dans le faubourg ; nous apercevons de loin sa flèche aiguë. Le lecteur nous en voudrait d’avoir manqué de visiter une église gothique de 1839. Nous sortons donc de la ville sous un arc de triomphe dans le goût italien du quatorzième siècle, orné d’une large fresque représentant des batailles bavaroises ; un quart de lieue plus loin, nous rencontrons l’église bâtie aussi comme tous les autres monumens, de briques réchampies de plâtre. Cette église est petite et n’est pas entièrement finie à l’intérieur. On y pose encore une foule de petits saints-statuettes en plâtre peint. Le carton-pierre y domine : c’est-là une grande calamité. Les vitraux sont mieux que le gothique ; d’après les nouveaux procédés et les découvertes de la chimie, on parvient à obtenir de grands sujets sur un seul verre, au lieu d’employer de petits vitraux plombés ; le dallage est fait en bitume de couleur ; les sculptures de bois sont figurées parfaitement en pâte colorée, les flambeaux et les crucifix sont en métal anglais, se nettoyant comme l’argent. J’ai pu monter dans la flèche, qui m’a rappelé celle de la cathédrale de Rouen refaite par M. Alavoine.
Cette dernière est un morceau dont les Rouennais sont bien fiers. On sait que l’ancienne flèche de Rouen, rivale de celle de Strasbourg et d’Anvers, avait été brûlée il y a quelques années. Le conseil municipal de Rouen décida qu’on la reconstruirait en fer creux ; ce qui s’est fait. Maintenant, cette flèche durera plus que l’église elle-même ; c’est léger, économique, incombustible ; cela se démonte avec des boulons, cela peut se revendre au poids. Seulement, vu d’en bas, ce clocher est grêle et mesquin ; c’est un clocher-araignée ; cela ressemble à un mât garni de ses cordages ; c’est une flèche étique, amaigrie ; cela gâte la vue de Rouen, si gâtée déjà par son pont de fer et son quai de belles maisons.
Mais, revenons à Munich : la flèche en fer creux est un sacrifice au progrès, et nous ne voulons pas trop l’en blâmer. En revanche, elle a toujours les deux belles tours de sa cathédrale, le seul monument ancien qu’elle possède, et qu’on aperçoit de six lieues. Au temps où fut bâti ce noble édifice, on mettait des siècles à accomplir de telles œuvres ; on les faisait de pierre dure, de marbre ou de granit ; alors aussi, on n’improvisait pas en dix ans une capitale qui semble une décoration d’opéra prête à s’abîmer au coup de sifflet du machiniste. Que le roi-poète me pardonne ces critiques sévères ; avant de faire des bâtisses, il faisait des livres, signés de son nom royal, avec les armes de Bavière au frontispice ; il s’est donc reconnu de tous temps justiciable du feuilleton.
D’ailleurs, nous comprenons que l’ancien duché de Bavière, qui est passé royaume par la grâce de Napoléon, ait à cœur de se faire une capitale avec une ancienne petite ville mal bâtie, qui n’a pas même de pierres pour ses maçons ; mais Napoléon lui-même n’aurait pu faire que la population devînt en rapport avec l’agrandissement excessif de la ville ; il eût simplement déporté là des familles qui y seraient mortes d’ennui, comme les tortues du Jardin-des-Plantes ; il n’aurait pu faire un fleuve de l’humble ruisseau qui coule à Munich, et que l’on tourmente en vain avec des barrages, des fonds de planches et des estacades, pour avoir le droit un jour d’y bâtir un pont dans le goût romain. Hélas ! sire, roi de Bavière ! ceci est une grande consolation pour nous autres pauvres gens ; vous êtes roi, prince absolu, chef d’une monarchie à états, que vous nous priez de ne pas confondre avec notre monarchie constitutionnelle ; mais vous ne pouvez faire qu’il y ait de l’eau dans votre rivière et de la pierre dans le sol où vous bâtissez !
En rentrant dans la ville nous rencontrâmes plusieurs monumens nouveaux propres à immortaliser la gloire bavaroise sous toutes les formes. On remarque surtout un obélisque entièrement pareil au nôtre, mais tout en cuivre rouge comme la statue de Maximilien. Il est consacré aux trente mille Bavarois qui perdirent la vie dans la campagne de Russie ; nous ne nous y opposons pas.
On donnait au théâtre un vaudeville traduit, et la représentation de Medea, mélodrame en prose joué par Mme Schroder-Devrient, qui est, dit-on, la première tragédienne d’Allemagne. Cette actrice nous a rappelé Mlle Duchesnois dans ses derniers jours. La pièce était bouffonne, remplie de combats réglés, d’incendies et de meurtres et finissait par une illumination en flammes du Bengale. C’est donc là où en est réduit aussi l’art dramatique en Allemagne ? Mais du moins nos auteurs du boulevard ne choisissent point de sujets classiques. Un mélodrame intitulé Médée aurait eu peu de succès à la Porte-St-Martin.
FRITZ.
