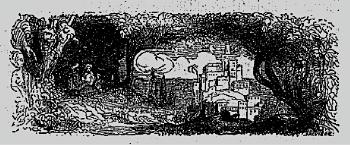1er juin 1845 — Souvenirs de l’archipel, Cérigo, Archéologie. Ruines de Cythère. Les trois Vénus, dans L’Artiste, 4e série, t. IV, p. 70-72, signé Gérard de Nerval.
L’article sera repris en 1848 dans Scènes de la vie orientale, chapitres V, « Aplunori », VI, « Palœocastro » et VII, « Les Tois Vénus » (tous numérotés V) ; en 1849 en feuilleton dans Al-Kahira. Souvenirs d’Orient (La Silhouette, 25 février et 4 mars), puis en volume en1851 dans l’Introduction du Voyage en Orient, chapitres XVI, « Aplunori », XVII, « Palœocastro », et XVIII, « Les Trois Vénus »
Un an après ses deux premiers articles intitulés Voyage à Cythère et Voyage à Cythère III et IV, Nerval revient sur l'évocation de son escale improvisée sur l'île de Cythère. L'article du 11 août 1844 s'arrêtait au moment où Nerval allait aborder l'ascension de la colline d'Aplunori. C'est cet aspect archéologique qu'il reprend ici en comparant ce qu'en ont dit deux envoyés de la République française lors de la conquête de l’île par l'armée de Bonaparte avec ce qu'il peut lui-même observer sur place, après les pillages opérés par l'occupation anglaise.
En quête de vestiges du culte de l’antique Vénus-Uranie, Nerval amorce ici sa réflexion sur le syncrétisme religieux autour de ce que Goethe nommait le « féminin céleste », réflexion prolongée et approfondie dans l'article intitulé Le Temple d’Isis. Souvenir de Pompéi publié dans La Phalange six mois plus tard.
Voir la notice 1843 LE VOYAGE EN ORIENT, VERS L'ORIENT
******
SOUVENIRS DE L’ARCHIPEL.
CÉRIGO.
ARCHÉOLOGIE. — RUINES DE CYTHÈRE. — LES TROIS VÉNUS.
La colline d’Aplunori ne présente que peu de ruines, mais elle a gardé les restes plus rares de la végétation sacrée, qui jadis parait le front des montagnes ; des cyprès toujours verts et quelques oliviers antiques dont le tronc crevassé est le refuge des abeilles, ont été conservés par une sorte de vénération traditionnelle qui s’attache à ces lieux célèbres. Les restes d’une enceinte de pierre protègent, seulement du côté de la mer, ce petit bois qui est l’héritage d’une famille ; la porte a été surmontée d’une pierre voûtée, provenant des ruines et dont j’ai signalé déjà l’inscription. Au delà de l’enceinte est une petite maison entourée d’oliviers, habitation de pauvres paysans grecs, qui ont vu se succéder depuis cinquante ans les drapeaux vénitiens, français et anglais sur les tours du fort qui protège San-Nicolo, et qu’on aperçoit à l’autre extrémité de la baie. Le souvenir de la république française et du général Bonaparte qui les avait affranchis en les incorporant à la république des sept îles, est encore présent à l’esprit des vieillards.
L’Angleterre a rompu ces frêles libertés depuis 1815, et les habitants de Cérigo ont assisté sans joie au triomphe de leurs frères de la Morée. L’Angleterre ne fait pas des Anglais des peuples qu’elle conquiert, je veux dire qu’elle acquiert, elle en fait des ilotes, quelquefois des domestiques ; tel est le sort des Maltais, tel serait celui des Grecs de Cérigo, si l’aristocratie anglaise ne dédaignait comme séjour cette îles poudreuse et stérile. Cependant il est une sorte de richesse dont nos voisins ont encore pu dépouiller l’antique Cythère, je veux parler de quelques bas-reliefs et statues qui indiquaient encore les lieux dignes de souvenir. Ils ont enlevé d’Aplunori une frise de marbre sur laquelle on pouvait lire, malgré quelques abréviations, ces mots qui furent recueillis en 1798 par des commissaires de la république française : Naoz Afrodithz qeaz Kuriaz Kuqhreiwu kai pantoz Kosmou , « Temple de Vénus, déesse maîtresse des Cythériens et du monde entier. »
Cette inscription ne peut laisser de doute sur le caractère des ruines ; mais en outre un bas-relief enlevé aussi par les Anglais avait servi longtemps de pierre à un tombeau dans le bois d’Aplunori. On y distinguait les images de deux amants venant offrir des colombes à la déesse, et s’avançant au delà de l’autel près duquel était déposé le vase des libations. La jeune fille, vêtue d’une longue tunique, présentait les oiseaux sacrés, tandis que le jeune homme, appuyé d’une main sur son bouclier, semblait de l’autre aider sa compagne à déposer son présent aux pieds de la statue ; Vénus était vêtue à peu près comme la jeune fille, et ses cheveux, tressés sur les tempes, descendaient en boucles sur le col.
Il est évident que le temple situé sur cette colline n’était pas consacré à Vénus Uranie, ou céleste adorée dans d’autres quartiers de l’île, mais à cette seconde Vénus, populaire ou terrestre qui présidait aux mariages. La première, apportée par les habitants de la ville d’Ascalon en Syrie, divinité sévère au symbole complexe, au sexe douteux, avait tous les caractères des images primitives surchargées d’attributs et d’hiéroglyphes, telles que la Diane d’Ephèse ou la Cybèle de Phrygie ; elle fut adoptée par les Spartiates, qui les premiers avaient colonisé l’île ; la seconde, plus riante, plus humaine, et dont le culte, introduit par les Athéniens vainqueurs, fut le sujet de guerres civiles entre les habitants, avait une statue renommée dans toute la Grèce comme une merveille de l’art : elle était nue et tenait à sa main droite une coquille marine ; ses fils Eros et Antéros l’accompagnaient, et devant elle était un groupe de trois Grâces dont deux la regardaient, et dont la troisième était tournée du côté opposé. Dans la partie orientale du temple, on remarquait la statue d’Hélène, ce qui est cause probablement que les habitants du pays donnent à ces ruines le nom de palais d’Hélène.
Deux jeunes gens se sont offerts à me conduire aux ruines de l’ancienne ville de Cythère dont l’entassement poudreux s’apercevait le long de la mer entre Aplunori et le port de San-Nicolo ; je les avais donc dépassées en me rendant à Potamos par l’intérieur des terres ; mais la route n’était praticable qu’à pied, et il fallut renvoyer le mulet au village. Je quittai à regret ce peu d’ombrage plus riche en souvenirs que les quelques débris de colonnes et de chapiteaux dédaignés par les collectionneurs anglais. Hors de l’enceinte du bois, trois colonnes tronquées subsistaient debout encore au milieu d’un champ cultivé ; d’autres débris ont servi à la construction d’une maisonnette à toit plat, située au point le plus escarpé de la montagne, mais dont une antique chaussée de pierre garantit la solidité. Ce reste des fondations du temple sert de plus à former une sorte de terrasse qui retient la terre végétale nécessaire aux cultures et si rare dans l’île depuis la destruction des bois consacrés aux divinités.
On trouve encore sur ce point une excavation provenant de fouilles ; une statue de marbre blanc drapée à l’antique, et très-mutilée, en avait été retirée ; mais il a été impossible d’en déterminer les caractères spéciaux. En descendant à travers les rochers poudreux, variés parfois d’oliviers et de vignes, nous avons traversé un ruisseau qui descend vers la mer en formant des cascades, et qui coule parmi des lentisques, des lauriers-roses et des myrthes. Une chapelle grecque s’est élevée sur les bords de cette eau bienfaisante, et paraît avoir succédé à un monument plus ancien.
Nous suivions dès lors le bord de la mer en marchant sur les sables et en admirant de loin en loin des cavernes où les flots vont s’engouffrer dans les temps d’orage ; les cailles de Cérigo, fort appréciées des chasseurs, sautelaient çà et là sur les rochers voisins, dans les touffes de sauge aux feuilles cendrées. Parvenus au fond de la baie, nous avons pu embrasser du regard toute la colline de Palæocastro couverte de débris, et que dominent encore les tours et les murs ruinés de l’antique ville de Cythère. L’enceinte en est marquée sur le penchant tourné vers la mer, et les restes des bâtiments sont cachés en partie sous le sable marin qu’amoncelle l’embouchure d’une petite rivière. Il semble que la plus grande partie de la ville ait disparu peu à peu sous l’effort de la mer croissante, à moins qu’un tremblement de terre, dont tous ces lieux portent les traces, n’ait changé l’assiette du terrain. Selon les habitants, lorsque les eaux sont très-claires, on distingue au fond de la mer les restes de constructions considérables.
En traversant la petite rivière, on arrive aux anciennes catacombes pratiquées dans un rocher qui domine les ruines de la ville et où l’on monte par un sentier taillé dans la pierre. La catastrophe qui apparaît dans certains détails de cette plage désolée a fendu dans toute sa hauteur cette roche funéraire et ouvert au grand jour les hypogées qu’elle renferme. On distingue par l’ouverture les côtés correspondants de chaque salle séparés comme par prodige ; c’est après avoir gravi le rocher qu’on parvient à descendre dans ces catacombes qui paraissent avoir été habitées récemment par des pâtres ; peut-être ont-elles servi de refuge pendant les guerres, ou à l’époque de la domination des Turcs.
Le sommet même du rocher est une plate-forme oblongue, bordée et jonchée de débris qui indiquent la ruine d’une construction beaucoup plus élevée ; peut-être était-ce un temple dominant les sépulcres et sous l’abri duquel reposaient des cendres pieuses. Dans la première chambre que l’on rencontre ensuite, on remarque deux sarcophages taillés dans la pierre et couverts d’une arcade cintrée ; les dalles qui les fermaient et dont on ne voit plus que les débris étaient seules d’un autre morceau ; aux deux côtés, des niches ont été pratiquées dans le mur, soit pour placer des lampes ou des vases lacrymatoires, soit encore pour contenir des urnes funéraires. — Mais s’il y avait ici des urnes, à quoi bon plus loin des cercueils ? Il est certain que l’usage des anciens n’a pas toujours été de brûler les corps, puisque, par exemple, l’un des Ajax fut enseveli dans la terre ; mais si la coutume a pu varier selon les temps, comment l’un et l’autre mode aurait-il été indiqué dans le même monument ? Se pourrait-il encore que ce qui nous semble des tombeaux ne soit que des cuves d’eau lustrales multipliées pour le service des temples ? Le doute est ici permis comme à l’égard des prétendus sarcophages trouvés dans l’intérieur des pyramides de Gizeh. — Quoi s’il en soit, l’ornement de ces chambres paraît avoir été fort simple comme architecture ; aucune sculpture, aucune colonne n’en vient varier l’uniforme construction ; les murs sont taillés carrément, le plafond est plat, seulement l’on s’aperçoit que primitivement les parois ont été revêtues d’un mastic où apparaissent des traces d’anciennes peintures exécutées en rouge et en noir à la manière des Etrusques.
Des curieux ont déblayé l’entrée d’une salle plus considérable pratiquée dans le massif de la montagne ; elle est vaste, carrée et entourée de cabinets ou cellules, séparés par des pilastres et qui peuvent avoir été soit des tombeaux, soit des chapelles, car selon bien des gens cette excavation immense serait la place d’un temple consacré aux divinités souterraines.
Il est difficile de dire si c’est sur ce rocher qu’était bâti le temple de Vénus céleste, indiqué par Pausanias comme dominant Cythère, ou si ce monument s’élevait sur la colline encore couverte des ruines de cette cité, que certains auteurs appellent aussi la ville de Ménélas. Toujours est-il que la disposition singulière de ce rocher m’a rappelé celle d’un autre temple d’Uranie que l’auteur grec décrit ailleurs comme étant placé sur une colline hors des murs de Sparte. Pausanias lui-même, Grec de la décadence, païen d’une époque où l’on avait perdu le sens des vieux symboles, s’étonne de la construction toute primitive des deux temples superposés consacrés à la déesse. Dans l’un, celui d’en bas, on la voit couverte d’armures, telle que Minerve (ainsi que la peint une épigramme d’Ausone) ; dans l’autre, elle est représentée entièrement couverte d’un voile, avec des chaînes aux pieds. Cette dernière statue, taillée en bois de cèdre, avait été, dit-on, érigée par Tyndare et s’appelait Morpho, autre surnom de Vénus. Est-ce là la Vénus souterraine, la Vénus du sommeil et de la mort ? celle qu’on représentait aux enfers, unissant Pluton à la froide Perséphone, et qui, encore sous le surnom d’Aînée des Parques, se confond parfois avec la belle et pâle Némésis ?
On a souri des préoccupations de ce poétique voyageur, « qui s’inquiétait tant de la blancheur des marbres » ; peut-être s’étonnera-t-on dans ce temps-ci de me voir dépenser tant de recherches à constater la triple personnalité de la déesse de Cythère. Certes, il n’était pas difficile de trouver dans ses trois cents surnoms et attributs la preuve qu’elle appartenait à la classe de ces divinités panthées, qui présidaient à toutes les forces de la nature dans les trois régions du ciel, de la terre et des lieux souterrains. Mais j’ai voulu surtout montrer que le culte des Grecs s’adressait principalement à la Vénus austère, idéale et mystique, que les néo-platoniciens d’Alexandrie purent opposer, sans honte, à la Vierge des chrétiens. Cette dernière, plus humaine, plus facile à comprendre pour tous, a vaincu désormais la philosophique Uranie. Aujourd’hui la Panagia grecque a succédé sur ces mêmes rivages aux honneurs de l’antique Aphrodite ; l’église ou la chapelle se rebâtit des ruines du temple et s’applique à en couvrir les fondements ; les mêmes superstitions s’attachent presque partout à des attributs tout semblables ; la Panagia, qui tient à la main un éperon de navire, a pris la place de Vénus Pontia ; une autre reçoit, comme la Vénus Calva, un tribut de chevelures que les jeunes filles suspendent aux murs de sa chapelle. Ailleurs s’élevait la Vénus des flammes, ou la Vénus des abîmes ; la Vénus Apostrophia, qui détournait des pensées impures, ou la Vénus Péristeria, qui avait la douceur et l’innocence des colombes : la Panagia suffit encore à réaliser tous ces emblèmes. Ne demandez pas d’autres croyances aux descendants des Achéens ; le christianisme ne les a pas vaincus, ils l’ont plié à leurs idées ; le principe féminin, et, comme dit Goëthe, le féminin céleste règnera toujours sur ce rivage. La Diane sombre et cruelle du Bosphore, la Minerve prudente d’Athènes, la Vénus armée de Sparte, telles étaient leurs plus sincères religions : la Grèce d’aujourd’hui remplace par une seule vierge tous ces types de vierges saintes, et compte pour bien peu de chose la trinité masculine et tous les saint de la légende, à l’exception de saint Georges, le jeune et brillant cavalier.
En quittant ce rocher bizarre, tout percé de salles funèbres, et dont la mer ronge assidûment la base, nous sommes arrivés à une grotte que les stalactites ont décorée de piliers et de franges merveilleuses ; des bergers y avaient abrité leurs chèvres contre les ardeurs du jour ; mais le soleil commença bientôt à décliner vers l’horizon, en jetant sa pourpre au rocher lointain de Cérigotto, vieille retraite des pirates ; la grotte était sombre et mal éclairée à cette heure, et je ne fus pas tenté d’y pénétrer avec des flambeaux ; cependant tout y révèle encore l’antiquité de cette terre aimée des dieux. Des pétrifications, des fossiles, des amas mêmes d’ossements antédiluviens ont été extraits de cette grotte ainsi que de plusieurs autres points de l’île. Ainsi ce n’est point sans raison que les Pélasges avaient placé là le berceau de la fille d’Uranus, de cette Vénus si différente de celle des peintres et des poëtes, qu’Orphée invoquait en ces termes : « Vénérable déesse, qui aimes les ténèbres... visible et invisible... dont toutes choses émanent, car tu donnes des lois au monde entier, et tu commandes même aux Parques, ô souveraine de la nuit ! »
GÉRARD DE NERVAL.