
JUSTIN DUBURGUA
Justin Duburgua fut pour Nerval une figure mythique, au point de l’incorporer en 1841 dans sa propre famille, au cœur de sa Généalogie, et d’en faire le héros d’un roman épistolaire que l’on a longtemps cru autobiographique, Un Roman à faire.
Que savons-nous de Justin Duburgua? Sa famille est originaire d’Aiguillon, près d’Agen Les archives privées et d’état civil du Lot-et-Garonne montrent que le père de Justin, Pierre François Duburgua, est maître chirurgien, « accoucheur des femmes pauvres » précise le registre des pensions d’Aiguillon pour la période 1779-1781. Il est lui-même le fils de Bertrand Duburgua, « maître chirurgien juré ». Des quatre enfants connus de Pierre François et de son épouse Marguerite Tartas, Justin est le dernier, né le 8 août 1780, à Bordeaux.
Les Duburgua sont ce que l’on peut appeler une famille de notables à Aiguillon. Le registre des dépenses de la ville pour la période 1734-1737 fait état d’une rémunération de 300 livres à Duburgua, prêtre, pour la prédication de l’Avent et du Carême. Un Jean Duburgua (1741-1770) est notaire royal, paroisse de Granges, un Joseph Duburgua est huissier royal à Prayssas. Dans la période qui nous occupe, c’est un Duburgua qui est vicaire de la paroisse Saint-Félix–Saint-Pierre d’Aiguillon.
La courte vie de Justin Duburgua, que nous avons pu reconstituer à partir de la notice nécrologique prononcée par Saint-Amans devant ses collègues de la Société savante d’Agen le 23 Germinal an XII (13 avril 1804) et de son dossier conservé aux Archives de la Défense, avait de quoi frapper l’imagination de Nerval.
Il sortait à peine de l’enfance, lorsqu’en 1793, les dangers de la patrie furent proclamés » dit Saint-Amans. Par patriotisme, mais surtout « par amour de la gloire » dont il était « électrisé », l’adolescent s’engage, reçoit un sabre symbolique (comme le lieutenant Desroches, engagé à 14 ans, à qui il faut faire un fusil adapté à ses faibles forces, dans Le Fort de Bitche. Souvenir de la Révolution française, nouvelle publiée par Nerval en juin 1839), et part pour l’armée des Pyrénées occidentales, puis pour l’Italie. Là, tout en étant attaché au service des hospices militaires, il se remet aux études « dévoré de l’amour des sciences », devient l’ami et le disciple de Spallanzani, Fontana, Scapoli, Barattieri, et membre de l’Académie royale de Plaisance. Dix ans plus tard, dit encore Saint-Amans en arrondissant un peu, il rentre en France, vient à Paris parfaire ses études, et est nommé « professeur de physique et de chimie au Cap-Français ». Parti à Saint-Domingue en « fructidor an X », il y travaille quelques mois sur la flore et la faune de l’île avant d’être enlevé par l’épidémie de fièvre qui ravage alors Saint-Domingue. Il laissait trois ouvrages, publiés ensemble chez des libraires parisiens en 1803 : Le Newtonianisme de l’amitié, l’Éloge du comte Barattieri et un Essai sur les sensations de l’odorat et du goût.
Cette notice nécrologique est un portrait quelque peu idéalisé, qu’il convient de corriger en examinant le dossier militaire de Justin. Il s’est bien enrôlé dans l’armée des Pyrénées orientales (et non occidentales) à 13 ans, en 1793, dit-il dans une lettre, encore que la première note de service le concernant n’indique que la date de 1795 : « Requis à La Jonquière, 1er germinal an III (21 mars 1795) ». Il fut blessé, fait prisonnier et rendu, dit-il encore. Ayant fait avant de s’enrôler quelques études de pharmacie à Montpellier, il est engagé dans l’armée d’Italie le 20 ventôse an IV (10 mars 1796), comme pharmacien de 3e classe, en poste à Plaisance et Milan. De Milan, il écrit une lettre enflammée au ministre de la guerre pour obtenir de combattre: « Moi aussi je voulais attirer sur ma tête un rayon de gloire… Le sang des soldats de l’aigle viendra rougir mon bras. Sur un tas de morts je mériterai le poste dont vous aurez daigné m’honorer ». (lettre du 18 germinal an V / 7 avril 1797). Zèle très excessif chez un garçon qui n’a pas encore 17 ans, et qui lui vaut ce sage conseil de la part du ministère : « appliquer l’ardeur qu’il manifeste pour les combats à l’exercice de ses devoirs auprès des malades ». Mais visiblement, Justin n’a aucune envie de faire carrière dans la pharmacie militaire.
Six mois plus tard, le 29 fructidor an V (15 septembre 1797) il écrit de nouveau au ministre de la guerre pour demander à être versé dans la marine, et pouvoir ainsi se rendre à Saint-Domingue où, dit-il, il a « quelques propriétés ». Information fort intéressante pour nous car elle explique la présence sur la Généalogie de Nerval du nom de Saint-Domingue à proximité de celui de Duburgua. Nouvelle réponse négative, le 24 vendémiaire an VI (15 octobre 1797). Nouvelle tentative auprès du ministre en avril 1798, alors qu’il est employé depuis décembre 1797 aux Iles du Levant, cette fois pour entrer dans l’École du Génie de l’armée. Nouveau refus.
Si Duburgua a commencé à prendre des contacts avec les Sociétés savantes de Plaisance à ce moment, le dossier militaire n’en dit bien sûr rien. En revanche, il nous révèle l’accident dont il fut victime en 1798, et que la notice de Saint-Amans passe au contraire sous silence. En juillet 1798, il fut envoyé en mission à Cérigo (Cythère, à la pointe du Péloponnèse) sur une frégate française, et fut blessé lors d’une altercation avec une frégate anglaise au large de Corfou. Blessure à la jambe gauche, sérieuse, au vu du rapport du chirurgien de l’hôpital de Corfou : « fracture compliquée de la jambe gauche, qui a été suivie de gangrène… à la suite d’une playe d’arme à feu reçue sur un brick français dans un combat avec une frégate anglaise, lorsqu’il se rendait à Cérigo pour le service ». Il semble que la suite de la carrière militaire de Duburgua ne soit qu’un long calvaire jalonné de déceptions. Ses demandes d’affectation dans les hôpitaux de l’intérieur, pourtant soutenues par le Conseiller d’État Jean Girard Lacuée, comme lui originaire des environs d’Agen, ancien chef d’État Major des armées des Pyrénées et pour l’heure membre du Conseil des Anciens, demeurent vaines, et c’est avec beaucoup d’amertume qu’il demande enfin à être licencié avec indemnité, ce qui lui est accordé après examen de la commission de santé de Plaisance, qui a d’ailleurs détecté chez lui une phtisie commençante, le 7 thermidor an IX (26 juillet 1801).
On voit mal, donc, quand Duburgua aurait pu, comme le dit Saint-Amans, venir à Paris y faire ses études de physique et y prendre ses grades. De la même manière, ce n’est pas comme enseignant que Duburgua partit pour Saint-Domingue, mais comme pharmacien de 2e classe affecté le 3 messidor an X (22 juin 1802) au corps expéditionnaire de répression contre Toussaint Louverture. Débarqué le 6 frimaire an XI (27 novembre 1802), il meurt au Cap le 15 nivôse an XI (5 janvier 1803).
Avant de partir pour Saint-Domingue, Justin Duburgua a déposé un double manuscrit, l’Éloge du comte C. Barattieri et Le Newtonianisme de l’amitié, paru en un volume à Paris chez Allut en 1803, qui nous éclaire sur ce qui, dans la nature et le caractère de Duburgua, a pu frapper l’imagination de Nerval au point d’en faire le héros tragique d’Un Roman à faire. Curieux effet de miroir, où Duburgua se reconnaît en Barattieri, et Nerval en Duburgua.
L'Éloge commence par une courte autobiographie qui explique comment Justin fit la connaissance du savant italien Barattieri : « Arraché du sein de l’instruction par la loi qui m’appelait aux armes, je fus privé, malgré moi, de ces leçons sublimes qui rendent l’homme digne de lui-même, pour payer à la patrie la dette que chacun de ses enfans lui doit. » En Italie, Justin découvre avec ravissement un milieu savant très accueillant et actif. Il se lie d’amitié à Plaisance avec Barattieri, en qui il semble reconnaître une âme sœur : « Né avec un cœur sensible et brûlant, il fut plus affecté que d’autres du sort rigoureux qui le condamnait, comme cadet de famille, à ne jamais prétendre au doux nom d’époux et de père. Il sut supporter ses maux en imposant silence aux passions qui lui criaient de braver l’usage barbare qui le vouait à d’éternels regrets. Miné par la douleur, il voulut fuir le climat où tout lui semblait plein de l’objet auquel il devait renoncer : il chercha le calme en voyageant… » Situation de cadet de famille, passion malheureuse, divertissement par le voyage, tout cela ne manque pas d’évoquer Justin lui-même, et son double, l’auteur des lettres d’Un Roman à faire.
Justin Duburgua admire encore chez le savant italien la compassion qui le met à l’écoute des pauvres: « Le comte Barattieri était bon, sensible, doux, mais vif et fier envers ceux qu’il n’estimait pas ; trop franc peut-être, pour vivre à la cour... Le peuple dont le témoignage n’est jamais faux, avait pour lui autant d’amour que de vénération. » Il semble y avoir là le souvenir ému de la compassion qui animait aussi le père de Justin, Pierre François Duburgua, médecin des pauvres. C’est avec la violence du chagrin de qui a perdu un père que Justin Duburgua termine: « ta perte est irréparable!... ta mort est pour moi la nuit des tempêtes : j’errerai seul dans le dédale de la vie... »
Comment, en lisant ces lignes, Nerval ne se serait-il pas senti concerné par l’aveu de cette angoisse de la perte et de l’absence ? Et plus encore peut-être par la peinture que fait Duburgua de son propre tempérament de mélancolique dans l’Avant-Propos du Newtonianisme de l’amitié : « Solitaire au milieu de tous, éloigné de ces plaisirs qui font le charme de mon âge, le malheur, un caractère triste me portèrent à chercher dans les sciences, des consolations que je ne pouvais trouver ailleurs. L’étude absorba tous mes momens; et si je ne fus pas heureux, j’appris à supporter mes maux. » On croirait entendre Louis Lambert ou Albert de Rudolstadt.
Le projet du Newtonianisme de l’amitié, dit encore Duburgua dans son Avant-Propos, est né du hasard d’une rencontre : « J’avais un ami que l’infortune avait plus cruellement frappé que moi: arraché du sein de l’instruction, par la loi qui l’appelait aux armes ; sans appui, sans fortune, il allait perdre tous les fruits d’une éducation première, lorsque je m’efforçai de le soutenir dans cette pénible circonstance. À dix-huit ans, l’amitié me força de m’instruire pour deux. » Si l’on ne savait qu’Étienne Labrunie n’a jamais été incorporé à l’armée d’Italie, on aurait aimé imaginer que l’ami sans fortune, c’était lui. Le projet, encouragé par son supérieur l’officier de santé Feret (dont le nom apparaît en effet sur une note de service de novembre 1800) prend corps sous la forme d’une correspondance entre le jeune maître et son disciple.
Le modèle littéraire du Newtonianisme, est Algarotti, que reçurent Madame du Châtelet et Voltaire à Cirey. Et quand la comtesse Roxane de Somaglia, femme savante du petit cercle que fréquente Duburgua, lui demande pourquoi son élève n’est pas une femme en ajoutant : « Il m’eût été si doux d’être la vôtre », Justin a cette dérobade toute nervalienne : « Non, madame, je n’ai pas dédaigné votre sexe, je l’ai redouté: voilà mon excuse. »
Reste à affronter le jugement public: « Qu’il est effrayant ce premier pas qu’on fait dans la carrière littéraire! oh! que je plains ceux qui ont comme moi la manie d’écrire... Mes nuits sont troublées par des songes nés de la confusion de mes idées pendant le jour. » Inutile de souligner ici encore l'accent proprement nervalien dans l'évocation de la surexcitation nerveuse provoquée par l'excès d'activité cérébrale, et des « songes nés de la confusion des idées » qui en découlent. Ce jugement du public, Justin Duburgua n’aura pas à l’affronter, puisqu’il s’est embarqué pour Saint-Domingue. Démarche suicidaire : déjà infirme et phtisique, il ne peut pas ne pas savoir dans quel enfer il va tomber.
Il y avait, dans le destin tragique de Justin Duburgua largement de quoi alimenter la rêverie de Nerval. En 1834, de passage à Agen, il a vu Charles Duburgua le frère de Justin, et peut-être sa ou ses sœurs (Macary et Anthoine dans la Généalogie fantastique). A-t-il reçu d’eux des souvenirs, et pourquoi pas, découvert ainsi le « paquet de lettres écrites sur papier assez gros, qui gisait sous le nœud d’un ruban passé au fond d’une valise d’officier de marine » qu’il évoque en prologue d’Un Roman à faire, émouvants souvenirs conservés et remontés à sa mémoire dans les jours de sa propre détresse de 1841 ? En tout cas, fin 1842, il décide de publier les lettres du « chevalier Dubourjet », comme un devoir pieux « à l’égard d’une âme qui a réellement pensé et souffert. »
Le 22 décembre 1842, Nerval quitte Paris pour l’Orient. Il laisse aux bureaux de La Sylphide, la revue de Villemessant, un article qui paraîtra dans la quatrième série, t. VII, 1843, non signé (alors que dans la livraison précédente il a signé Gérard de Nerval son article intitulé Les Vieilles ballades françaises), sous le titre d'Un Roman à faire.
Un Roman à faire est constitué de six lettres d’amour, accompagnées d’un prologue et d’un épilogue. Nous n’avons plus de cet article ni le manuscrit, ni les épreuves, sans doute jetés après composition puisque l'auteur n'était plus là pour les récupérer, et nous ne pouvons par conséquent savoir si ce titre est le fait de Nerval ou de Villemessant. L’enjeu pourtant est de taille : si c’est Nerval qui a choisi le mot « roman », on est délibérément dans la fiction romanesque. S’il est choisi par Villemessant comme plus attractif pour ses lecteurs, rien n’empêche de penser que Nerval utilise ici des documents authentiques maquillés en fiction. Faisons cette hypothèse en relisant Un Roman à faire :
Le narrateur, celui qui dit je, se présente comme dépositaire d’un paquet de lettres qu’ « une de ses parentes éloignées » a mis en sa possession. On a vu que dans sa Généalogie, Nerval considère les Duburgua comme faisant partie de sa famille. Ces lettres gisaient au fond d’une valise d’officier de marine, avec des cahiers de pensées et de poésies, et un seul ouvrage imprimé, en 1803, traitant de sciences physiques et « dédié et adressé par lettres à une puissante et sévère Uranie. » Tout cela renvoie fort exactement à Duburgua : la malle embarquée avec lui pour Saint-Domingue dut être restituée à la famille, et l’ouvrage de « sciences physiques » est évidemment Le Newtonianisme. Une seule inexactitude : les lettres qui composent Le Newtonianisme ne sont pas adressées à une femme (comme le souhaitait, on l’a vu plus haut, la comtesse Somaglia), mais à un ami, nommé Ariste. Si nous laissons de côté cette petite inexactitude, et la date erronée de 1808 (« le chevalier Dubourjet étant mort en 1808 ») qui peut n’être qu’une coquille de typographe – Nerval n’était plus là pour relire les épreuves –, le reste s’intègre parfaitement à la réalité.
Quant aux six lettres d’amour, le narrateur dit qu’elles sont un choix qu’il a fait dans un ensemble plus important, ce que confirmerait les manuscrits des lettres que l’on a dites « d’amour » faute de mieux, qui en comporte un nombre beaucoup plus important, copié de la main de Nerval. Dans Un Roman à faire, ces lettres sont adressées à la comtesse Pall…, épouse, dit le narrateur dans l’épilogue, « d’un personnage que son rang n’avait pas empêché de se livrer aux sciences physiques et dont le nom se trouve inscrit dans plusieurs recueils ». Pall…, Spall… Spallanzani, que fréquenta Duburgua pendant son séjour italien, si grand scientifique et si peu moine, décédé en 1799? On songe à un couple semblable à celui, explicitement évoqué par Duburgua, dans son Avant-Propos, que formaient Voltaire et Mme du Châtelet à Cirey, funestement troublé par l’arrivée du jeune Algarotti, modèle justement que se donne Justin Duburgua pour son Newtonianisme.
L’auteur des lettres est un passionné, amoureux timide et exalté, obsédé par l’idée que le bonheur n’est pas pour lui, qui correspond au portrait que Duburgua fait de lui-même: « Solitaire au milieu de tous, éloigné de ces plaisirs qui font le charme de mon âge, le malheur, un caractère triste me portèrent à chercher dans les sciences des consolations que je ne pouvais trouver ailleurs », et plus encore à la lettre du 21 fructidor an IX / 8 septembre 1801 adressée à la commission de santé de Plaisance : « Je ne me plaindrai que de moi seul, il est des hommes que le destin condamne à un malheur éternel ; j’en ai fait la triste expérience. » Tempérament mélancolique, voire suicidaire, qui s’accorde aussi avec l’aventure napolitaine de la Lettre III, dont on sait la fortune qu’elle aura dans l’imaginaire de Nerval, sujet de L’Illusion, parue dans L’Artiste en 1845, et d’Octavie, dans Le Mousquetaire fin 1853, et qui peut tout aussi bien être celle de Duburgua que celle de Nerval. Duburgua a fait, à l'exemple de Spallanzani, le voyage à Naples, une note de service du dossier militaire l’atteste en date du 29 vendémiaire an VIII (21 octobre 1799) : « en congé à Naples ». Faut-il rapprocher du personnage de la jeune et mystérieuse napolitaine qui parle un doux et incompréhensible dialecte de la Lettre III, une autre note du dossier militaire de Justin Duburgua, pour le moins énigmatique, en date du 13 messidor an VI (2 juillet 1798) – la veille donc de la déclaration d’accident par le chirurgien de Corfou –, mais très difficile à déchiffrer : « mauvais sujet à licencier – a été traduit devant un conseil militaire pour avoir enlevé (?) une jeune grecque ».
Dans l’épilogue, Nerval – et cette fois, c'est bien en son nom qu'il s'interroge – évoque sur le mode de l’irréel du présent les potentialités romanesques de son récit : « Un romancier moderne percevrait là... la ressemblance serait féconde... la science pourrait... », qu’il récuse comme un sacrilège : « On ne peut mêler le faux au vrai sans risquer une sorte de profanation. »
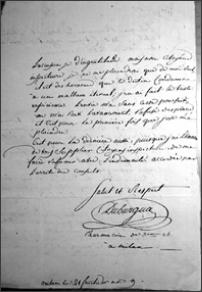


Bulletin de la Société savante d'Agen, où parut en 1804 la notice nécrologique de Justin Duburgua, prononcée le 23 Germinal an XII (13 avril 1804) par Saint-Amans
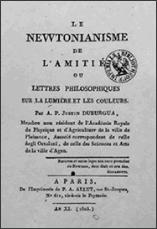

Le Newtonianisme de l'amitié et l'Éloge du comte Barattieri, publiés à Paris en 1803, alors que Justin Duburgua est déjà mort à Saint-Domingue
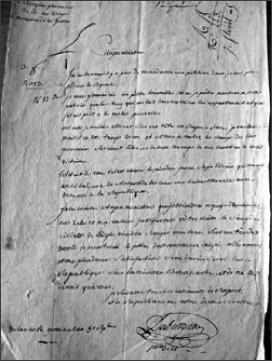
Lettre du 18 germinal an V (7 avril 1797):
Duburgua pharmacien 3e cl. au citoyen ministre de la guerre / Citoyen ministre, / J'ai eu l'honneur il y a peu de vous adresser une pétition dont je n'ai pu obtenir la réponse. Je vous demandais un poste honorable où je pusse montrer à ma patrie que le sang qui coulait dans mes veines lui appartenait et que j'étais prêt à le verser pour elle. / Moi aussi je voulais attirer sur ma tête un rayon de gloire. Je voulais: mais il en est temps encor et si vous le vouliez les champs de la Germanie seraient témoins de mon courage, de ma mort ou de ma victoire. Tel était le voeu, tel est encore l'espoir d'un jeune Républicain qui comme Annibal jura en sortant du berceau une haine éternelle aux ennemis de la République. J'ose croire, citoyen ministre que j'obtiendrai de que je demande, mon zèle et ma valeur justifieront votre choix. Le sang des soldats de l'aigle viendra rougir mon bras. Sur un tas de morts je mériterai le poste dont vous aurez daigné m'honorer, et ma plus douce satisfaction sera d'avoir servi la République sous l'invincible Bonaparte, et de ne le devoir qu'à vous. / Je suis avec tous les sentiments de respect et de républicanisme votre dévoué serviteur Duburgua / Milan, le 18 germinal an 5 de la République.
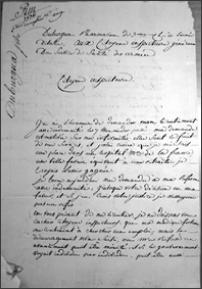
Lettre particulièrement amère envoyée par Duburgua aux inspecteurs du service de santé de l'armée d'Italie le 21 fructidor an IX (8 septembre 1801):
Duburgua pharmacien de 3e classe à l'armée d'Italie aux citoyens inspecteurs généraux du service de santé des armées / Citoyens inspecteurs / J'ai eu l'honneur de demander mon licenciement avec indemnité le 7 thermidor passé (26 juillet 1801). Ma demande est motivée sur mes infirmités; elles sont le fruit de mes services, et j'osai croire que je méritais une place dans un hôpital militaire de la France. Une telle faveur équivaut à une retraite, je croyais l'avoir gagnée. / Je borne aujourd'hui ma demande à ma réforme avec indemnité. J'invoque votre décision en ma faveur et si j'en crois votre justice, je n'essuyerai pas un refus. / En vous priant de me licencier, je ne dois pas vous cacher, citoyens inspecteurs, que ma modique fortune me contraint à chercher un emploi, mais le découragement m'a saisi, on m'a refusé un avancement peut-être mérité, et si le gouvernement voyait individu par individu, peut-être aussi l'accuserai-je d'ingratitude. Mais non, citoyens inspecteurs, je ne me plaindrai que de moi seul, il est des hommes que le destin condamne à un malheur éternel; j'en ai fait la triste expérience. L'envie m'a sans cesse poursuivi; on m'a ravi l'avancement, refusé des places et c'est pour la première fois que j'ose me plaindre. / C'est pour la dernière aussi, puisque j'ai l'honneur de vous supplier, citoyens inspecteurs, de me faire réformer avec l'indemnité accordée par l'arrêté des Consuls. / Salut et respect / Duburgua pharmacien de 3e classe à Milan / Milan le 21 fructidor an IX


Débarqué le 27 novembre 1802 à St-Domingue, Justin Duburgua meurt au Cap le 5 janvier 1803


La luxueuse revue La Sylphide, qui publia en décembre 1842 la nouvelle de Nerval Un Roman à faire.