GÉRARD DE NERVAL - SYLVIE LÉCUYER tous droits réservés @
CE SITE / REPÈRES BIOGRAPHIQUES / TEXTES / NOTICES / BELLES PAGES / MANUSCRITS AUTOGRAPHES / RECHERCHES AVANCÉES
NOTICES
« Les images de deuil et de désolation qui ont entouré mon berceau »
La Généalogie fantastique, Labrunie et Bonaparte, qui suis-je
les Dublanc
les Labrunie
les Paris de Lamaury
les Olivier
les Boucher
les Laurent
Carte des itinéraires valoisiens de Nerval
Le temps vécu de la petite enfance (1810-1815)
Le clos Nerval
L’oncle Antoine Boucher
Voix et Chansons
Les plaisirs et les jeux
Le temps des retours en Valois (1850-1854):
Le Valois transfiguré: Aurélia
Promenades en Valois, diaporama
LES ANNÉES CHARLEMAGNE
Père et fils rue Saint-Martin
Les cahiers de poésies de 1824
Le collège Charlemagne
Satiriste, anticlérical et anti-ultra
Auteur à 17 ans chez Ladvocat et Touquet
Pseudonyme Beuglant
LA CAMARADERIE DU PETIT CÉNACLE
1830, les Trois Glorieuses
Se rallier à Victor Hugo
L’atelier de Jehan Duseigneur
Traduire les poètes allemands
« En ce temp, je ronsardisais »
« Arcades ambo »
Jenny Colon
Le Monde dramatique
Le choix du nom de Nerval
La fin du Doyenné
L’expérience napolitaine:
Un Roman à faire
Octavie
Le Temple d’Isis. Souvenir de Pompéi
Élaboration fantasmatique et poétique:
A J-y Colonna
El Desdichado
Delfica
Myrtho
LE VOYAGE EN ALLEMAGNE DE 1838
« La vieille Allemagne notre mère à tous, Teutonia ! »
De Strasbourg à Baden et de Baden à Francfort
Les quatre lettres de 1838 au Messager
Les trois lettres de 1840 dans La Presse
Retour à Paris. Léo Burckart, heurs et malheurs du « beau drame allemand »
Les deux Léo Burckart
Espoir de reconnaissance et humiliation
Diplomate ou bohème?
Les Amours de Vienne
L’expérience viennoise fantasmée
Les Amours de Vienne. Pandora
Schönbrunn, belle fontaine et Morte fontaine
Décembre 1840 à Bruxelles
Les journées de février-mars 1841 à Paris
Les feuillets Lucien-Graux
Lettres à Bocage, Janin et Lingay
Hantise du complot
Éblouissement poétique:Lettres à Victor Loubens et à Ida Ferrier
Les sonnets « à Muffe »
L’itinéraire de Paris vers l’Orient: Marseille et Trieste
Le compagnon de voyage Joseph de Fonfrède
Escales dans l’Archipel grec :
Cythère
Syra
Visite aux pyramides
Adoniram et Balkis, Les Nuits du Ramazan :
Le projet de 1835
Le récit du conteur
Échos psychiques et littéraires
LE REGARD DES AUTRES
GEORGES BELL (1824-1889)

Georges Bell, de son vrai nom Joachim Hounau, a fait la connaissance de Nerval à Marseille, au retour du voyage en Orient, chez Méry. De seize ans plus jeune que Nerval, il l’a cependant assez intimement connu pour recevoir ses confidences, au cours notamment des promenades faites ensemble dans les environs de Paris. Deux mois après la mort de Nerval, Bell publie plusieurs articles dans L’Artiste en mars-avril 1855, regroupés sous le titre : Études contemporaines, Gérard de Nerval chez Lecou, la même année. C’est le témoignage sobre, fidèle et particulièrement bien informé d’un ami, compagnon quotidien des dernières années de Nerval.
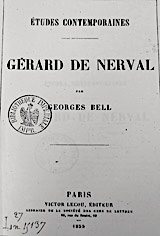
La façon de travailler de Nerval :
« Autant sa tête travaillait et remuait d’idées, autant sa main était paresseuse, pour ainsi parler. Il ne prenait la plume qu’au dernier moment, espérant sans cesse trouver et cherchant une forme meilleure pour exprimer ce qu’il avait à dire. Ce n’était qu’après une incubation longue et patiente, laborieuse toujours, et parfois même douloureuse, qu’il consentait à matérialiser sa pensée en la confiant au papier. Et alors encore des difficultés de détail, inaperçus pour tout autre, l’arrêtait à chaque instant. »
La petite enfance, l’adolescence, les réticences familiales, l’engagement politique libéral, comme son prère :
« Gérard Labrunie de Nerval est né au milieu des splendeurs militaires du premier Empire, et les fanfares guerrières ont accompagné ses premiers pas dans la vie. Il ne connut jamais sa mère, qui mourut dans une ville forte d’Allemagne, avant d’avoir recueilli le premier sourire de son enfant ; son père, médecin militaire, suivait la grande armée ; de telle sorte que Gérard fut confié aux soins d’un oncle maternel, qui l’emmena dans le Valois et l’éleva aux champs, émerveillant son enfance de tous ces récits aristocratiques qui sont les légendes des pays par lesquels ont sans cesse passé les seigneurs féodaux et les grands seigneurs de la cour. Les guerres finies, l’enfant avait retrouvé son père. Avec lui il vint habiter Paris, et fit ses études au collège Charlemagne. Cependant les vacances le ramenaient périodiquement dans le Valois, et là il retrouvait tous ses compagnons et tous ses souvenirs du village, compagnons qu’il n’oublia jamais et qu’il allait souvent revoir, même dans les dernières années ; souvenirs qu’il aimait et qu’il caressait comme l’image lointaine et nuageuse d’un bonheur disparu !
〈...〉 De leurs courses à travers l'Europe, les pères avaient rapporté des connaissances linguistiques qu'ils faisaient entrer dans l'éducation de leurs enfants. C'est ainsi que Gérard de Nerval apprit la langue allemande, et, à dix-huit ans, il publia la traduction du Faust de Goethe, qui eut un immense retentissement. Déjà, à cette époque, il avait la manie de l'obscurité qui l'a poussé à se dérober, sous une foule de pseudonymes, à une célébrité importune. Cette traduction est signée Gérard 〈...〉
Je viens de parler de la manie d'obscurité de Gérard de Nerval. Il nous l'expliquait un jour d'une façon qui mérite d'être rapportée. 'Ma famille, nous disait-il, me destinait à la diplomatie. Elle ne comprenait que ce moyen de satisfaire mes désirs immodérés de visiter tous les pays que je ne connaissais pas. Je voyais bien d'autres moyens ; mais je n'osais pas les dire, ils n'auraient pas été approuvés. Alors je gardais le silence et continuais à me livrer avec ardeur à mes travaux littéraires, mais en me cachant, cette cladestinité étant nécessaire pour ne pas nuire aux démarches diplomatiques que l'on faisait en ma faveur' 〈...〉
Ce que Gérard ne nous disait pas, ou plutôt ce qu'il ne nous a dit que dans les dernières années et lorsque la maladie le rendait plus expansif, c'est que, dans la société de son père, au milieux de vieux débris de l'Empire, il avait conçu des opinions politiques tranchées, et s'était enrôlé sous la bannière libérale. Il prit part, en poète, aux luttes qui amenèrent la chute de la Restauration, publia un volume d'Élégies nationales, qui semblaient un écho des Messéniennes, et plus tard, sous le gouvernement de Juillet, une brochure assez remarquable et fort rare, Opinion patriotique du père Gérard sur les événements. Ici vient se placer un fait mystérieux et dont Gérard de Nerval ne nous parlait jamais qu'avec des réticences. Vers cette époque, il subit un emprisonnement préventif et connut, à Sainte-Pélagie, la plupart des notabilités du parti républicain. Pourquoi cet emprisonnement ? Vingt fois nous avons mis Gérard de Nerval sur la voie de nous le dire, vingt fois ses lèvres sont restées muettes. Un jour seulement il nous promit d'écrire ses souvenirs de prison, et, en effet, quelques temps après, nous les trouvâmes dans L'Artiste, mais racontés avec cette manière délicate et voilée qui n'appartenait qu'à lui."
Les premières collaborations avec Paul Lacroix, Laurentie, Janin, Harel ; premiers essais dramaturgiques, Villon l'écolier, La Dame de Carouges, Tartufe chez Molière :
" Des dernières années de la Restauration date sa collaboration au Mercure de France, que dirigeait alors M. P. Lacroix, plus connu sous le nom de bibliophile Jacob. On ne signait guère alors les travaux qui paraissaient dans les publications périodiques. Cette coutume convenait parfaitement aux habitudes et aux goûts de Gérard de Nerval, et certes il se serait gardé d'y déroger, comme on se garde du feu 〈...〉
De ces mêmes années datent encore les premières relations de Gérard de Nerval avec M. Jules Janin. Les collections étaient à la mode, et M. J. Janin, mis en relief par la Quotidienne aux classiques français publiés par M. l'abbé Guillon, 〈...〉 et M. Laurentie 〈...〉 Gérard de Nerval désirait travailler à cette collection, et il fut par M. Laurentie renvoyé à M. Janin, qui en avait toute la direction littéraire. Ainsi commencèrent des relations qui n'ont cessé qu'à la dernière heure 〈...〉
M. J. Janin, à cette époque, était l'hôte de Harel, qui dirigeait le théâtre de l'Odéon, en attendant qu'il dirigeât celui de la Porte-Saint-Martin. Connaître M. J. Janin, c'était donc naturellement avoir ouverte la porte de Harel. Or, dans ce temps, de même qu'aujourd'hui, ce n'était pas une mince affaire que de pouvoir pénétrer familièrement jusqu'au cabinet d'un directeur. Tout le monde visait à donner à la scène française un répertoire nouveau. L'école romantique aventurait au théâtre des hardiesses fort séduisantes, surtout pour un esprit comme celui de Gérard de Nerval. L'Allemagne, le moyen-âge, l'Orient, s'amalgamaient dans sa tête, et il jaillissait de là une foule de combinaisons dramatiques. Tout ce que le théâtre contemporain a créé de neuf, on peut dire avec vérité que Gérard de Nerval l'a rêvé. Il ne s'en allait pas encore à cette époque, comme il l'a fait depuis, éparpillant à droite et à gauche et jetant ses idées dans toute oreille qui voulait l'entendre. Il n'avait pas encore désespéré de pouvoir tout réaliser lui-même 〈...〉
Voilà pourquoi, dans la connaissance de M. J. Janin, Gérard de Nerval recherchait la connaissance de Harel. Celui-ci était l'homme des entreprises hardies. Intelligent et habile comme pas un, il convenait admirablement aux instincts et aux aspirations de la jeunesse littéraire qui voulait se frayer une voie en passant sur le corps des auteurs dramatiques de l'époque impériale ; il avait tout ce qu'il fallait pour plaire à ces jeunes hommes avides de luttes et de renommée, plains d'ardeur et de foi ; il avait tout ce qu'il fallait pour les séduire : aussi accouraient-ils à lui de toutes parts. "
Dans le même temps, lecture des théosophes, des mystiques, de Swedenborg ; la voix douce et persuasive de Nerval :
" Toutes ces mésaventures, au lieu de décourager Gérard de Nerval, ne faisaient que le rendre plus âpre au travail. Comme un esprit qui cherche sa voie, il étudiait une foule de choses qu'on n'étudie guère de nos jours. Il trouvait surtout des jouissances infinies à s'initier aux mystères des sciences occultes. Il croyait avec une foi naïve à toutes les histoires de nécromancie et d'enchantement. Le monde invisible et supra naturel le comptait au nombre de ses plus fervents adeptes. Avec des lambeaux de la Kabbale, des rêveries mystiques de Cazotte, de la théosophie de Saint-Martin, des œuvres éparses de Swedenborg, qu'on connaissait à peine, il composait des théories à lui pour expliquer tout ce qui aurait pu le surperendre, et il croyait ferment à ces théories et à leur efficacité. Ce qu'il devint sous l'empire de ces études multipliées, il l'est resté toute sa vie 〈...〉 Tout cela peut nous paraître bizarre aujourd'hui. Mais tous nous y avons cru, ne fût-ce qu'un instant, quand Gérard de Nerval nous en parlait. Il avait dans la voix des inflexions si douces, qu'on se prenait à l'écouter comme on écoute un chant. Tous ceux qui ont entendu cette voix ne l'oublieront jamais. Hier encore elle m'était rappelée par un de ses amis les plus chers, Alfred Busquet. Alors qu'importaient les récits incroyables que nous faisait Gérard de Nerval ? On l'écoutait pour avoir le plaisir de l'entendre parler ; et, peu à peu, cette voix douce et mélodieuse vous tenait sous le charme. Votre esprit suivait l'esprit du poète dans le monde de ses rêves et se laissait bercer comme dans une ravissante illusion."
Nerval et l'argent, la dot de sa mère, l'haritage de son "oncle" 〈en fait son grand-père maternel, en 1834〉, ses périples aux environs de Paris, en Touraine et en Dordogne :
" Insoucieux de la gloire, au point de vue que nous avons marqué, Gérard de Nerval était encore plus insoucieux de l'argent. D'ailleurs, à cette époque, il n'avait nullement senti les rudes atteintes du besoin. La libre jouissance de la dot de sa mère lui avait été donnée à sa majorité, et il en usait largement pour satisfaire ses mille fantaisies de l'heure présente qui transformaient toutes les maisons par lesquelles il passait en magasins de bric-à-brac. D'une nature trop indépendante pour se créer le souci d'une fortune à gérer, il vivait avec ce patrimoine comme Jean de la Fontaine avec le sien, mangeant son fonds avec son revenu, et donnant un libre cours à sa manie voyageuse. Il était sans cesse par voies et par chemins, soit dans les environs de Paris, qu'il connaissait mieux que personne dans leurs plus mystérieux recoins, soit en Touraine, fouillant les anciennes demeures royales et seigneuriales qui ont éparpillé tant de richesses aristiques lors de la disparition des grandes existences de château, soit enfin dans cette portion du midi de la France que baigne la Dordogne, et où il avait des parents du côté de son père."
Le voyage en Italie, doutes et interrogations de Bell, réponses évasives de Nerval ; la jeune Anglaise rencontrée à Marseille et revue à Pompéi, récit rapporté des Filles du feu, confirmé en entretien avec Nerval, qui nourriront Octavie et certains sonnets des Chimères :
" C'est peut-être encore vers ces temps qu'il faut placer ses premiers voyages en Italie. Comme il écrivait peu à cette époque, et que lui-même ne nous a jamais rien dit de positif quant à la question de date, nous nous garderons bien de rien préciser à cet égard. Et cependant, il est bien certain qu'il avait vu l'Italie ; c'est même à Naples que, pour la première fois, il se trouva aux prises avec les besoins d'argent.
Au début de ce voyage, il fit, c'est lui-même qui le raconte dans les Filles du feu, rencontre à Marseille, aux bains de mer, d'une Anglaise charmante, dont la figure portait l'empreinte d'un mal poignant et contenu. Gérard de Nerval se sentit entraîné vers elle par une de ces attractions sympathiques qu'on n'explique pas, mais que tout le monde a ressenties. Ils nagèrent ensemble avec la liberté qu'autorise la mer. Entre deux vagues, la dame anglaise lui donna un petit poisson qu'elle venait de prendre avec la main, et glissa à son oreille ce mot presque mystérieux : 'Remember !⎼ Souviens-toi !' Cette scène, avec toutes les circonstances qui l'accompagnaient, ne pouvait manquer de produire un immense effet sur l'imagination naturellement exaltée de Gérard de Nerval. La figure de cette Anglaise ne devait plus sortir de sa mémoire. Il nous en a souvent parlé, surtout lorsqu'il rappela ce souvenir dans les Filles du feu. Il est vrai que, plus tard, lorsqu'il était à Naples, un jour qu'il visitait les ruines des villes englouties, il avait de nouveau rencontré cette dame, plus pâle encore et plus souffrante qu'à Marseille. Il lui avait montré le petit poisson desséché entre deux feuilles de son calepin de voyage. Un sourire mélancolique et triste s'était épanoui un instant sur des lèvres déjà blêmes, mais belles encore. Puis on s'était dit adieu, et tout s'était évanoui comme un rêve 〈...〉 Quand il rentrait à Paris, après ces courses qui duraient souvent plusieurs mois, Gérard de Nerval était possédé d'une passion immodérée de travail."
Première rencontre avec Dumas, l'argent prêté, le projet de la Reine de Saba avec Meyerbeer, la coproduction de L'Alchimiste et de Léo Burckart, le voyage de 1838 en Allemagne :
"Depuis longtemps déjà, Gérard de Nerval connaissait A. Dumas. Un hasard, un service rendu, les avait faits amis. Un jour, ils s'étaient rencontrés sur la place du Carrousel ; Dumas partait pour un voyage, Gérard rentrait au logis. Avant de partir, et afin d'oser se mettre en route, Dumas ramassait tout l'argent qu'il pouvait trouver. Il lui manquait un billet de cinq cents francs pour parfaire la somme qu'il avait assignée à ses dépenses. Gérard de Nerval, riche encore, avait le billet sur lui, et le fit passer promptement de son portefeuille dans celui de Dumas. De pareils services rendus et acceptés ainsi n'étaient pas rares à cette époque où la fraternité littéraire ne se bornait pas à un vain mot. Ils établissaient d'excellents rapports de camaraderie entre hommes suivant la même route et pouvant sans cesse et devant s'aider et s'encourager mutuellement.
Au moment où nous sommes arrivés, Dumas passait et pouvait passer, sans exagération ni flatterie, pour le plus habile faiseur dramatique du temps. Ce qui lui manquait, ce qui lui a toujours manqué, la faculté créatrice et inventive, d'autres avaient soin de l'avoir pour lui. Des propositions sans nombre de collaborations attendaient sans cesse l'auteur célèbre à sa porte, et les directeurs de théâtre, qui avaient la confiance la plus illimitée dans son habileté, avaient soin d'indiquer ce chemin à tous les jeunes gens désireux d'entrer dans la carrière dramatique 〈...〉
Ayant indiqué, comme nous l'avons fait, les relations qui existaient entre les deux hommes, on ne s'étonnera pas de voir Gérard de Nerval aller proposer à Dumas d'exploiter avec lui certaines idées dramatiques qui avaient fermenté dans son cerveau pendant ses pérégrinations. Dumas accepta d'autant plus volontiers qu'en ce moment on le désirait ardemment dans plusieurs théâtres. La collaboration devait embrasser plusieurs genres, drame, comédie, opéra même, Meyerbeer demandant aux littérateurs les plus en renom de lui confier un livret qui le délivrât de la collaboration de M. Scribe. Cette histoire d'opéra est l'origine de cette Reine de Saba, que rêvait Gérard de Nerval, et qu'il a mise enfin, faute de mieux, quinze ans plus tard, dans les Nuits de Rhamazan. Si l'on est curieux d'en relire tous les détails, beaucoup mieux racontés que nous ne saurions le faire nous-même, on peut ouvrir le charmant volume des Petits châteaux de la bohème 〈sic〉. On l'y trouvera tout au long 〈...〉
La collaboration avec Dumas établie, on se mit à l'œuvre, et deux pièces sortirent de ce travail en commun, deux grands drames en cinq actes. Tous les deux, par leur sujet et leur esprit, indiquent assez que la pensée première était de Gérard de Nerval. D’après une convention intervenue entre les deux auteurs, chacun devait signer seul l'une des pièces, afin de pouvoir plus facilement la classer dans ses œuvres. L'Alchimiste, qui fut joué sur le théâtre de la Renaissance, aujourd'hui salle des Italiens, échut à Dumas ; Léo Burckart, joué sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin, à Gérard de Nerval 〈...〉 A propos de Léo Burckart, j'ai souvent entendu nier la collaboration de Dumas, comme aussi, à propos de L'Alchimiste, celle de Gérard de Nerval. J'ai vu le manuscrit original de Léo Burckart ; il est écrit par les deux mains. Il était encore, au mois de septembre 1850, en la possession de M. Théodore Coignard, qui le tenait de Harel. Je ne sais pas s'il y est toujours.
Après avoir visité le midi de la France, la Suisse, l'Italie, Dumas voulut visiter l'Allemagne. Il trouvait dans ces déplacements continuels des sujets de livres à une époque où il n'écrivait guère encore que des impressions de voyage. Gérard de Nerval l'accompagna outre-Rhin. Il allait chercher sur cette terre, qu'il devait aimer d'un amour si fervent, le cadre du Léo Burckart, qui déjà se mouvait dans sa tête."
Retour un peu en arrière pour évoquer le goût des belleschoses de Nerval, la dot maternelle épuisée, l'héritage du clos Nerval, occasion d'une digression sur Adrienne et Sylvie :
" Gérard de Nerval, comme la plupart des hommes de cette génération, a vécu, tant qu'il l'a pu, d'une vie fort élégante. Toutes les fantaisies et toutes les commodités du luxe lui plaisaient et le séduisaient. Il aimait les parfums, les fleurs, les meubles de prix, surtout quand, au milieu de tout cela, venaient se mêler des femmes, ces êtres privilégiés de la beauté et de l'élégance. Tout dans ses manières était aristocratique, et on sentait, rien qu'en le voyant, que c'était un de ces hommes rares qui élèvent, ennoblissent et purifient tout ce qu'ils touchent. Il est fort dur, avec de pareils goûts et de pareils instincts, d'être privé de fortune, et cependant c'était là qu'en arrivait Gérard de Nerval, lorsque la mort de son oncle vint à propos lui donner un second patrimoine.
Au nombre des richesses qui échurent alors en partage à Gérard de Nerval, se trouvait une partie de ce domaine du Valois dans lequel il avait été élevé, domaine peuplé pour lui de souvenirs charmants, qu'il allait souvent retrouver en s'égarant, comme dans son enfance, sous les ombrages touffus qu'arrosent la Thève et la Nonette. Relisez Sylvie, dans les Filles du feu, vous y retrouverez un écho discret, quoique à peine voilé, des premières émotions du poète. Dans d'autres ouvrages encore, dans Adrienne* de Longueval (*en note : Adrienne était le nom primitif de l'histoire publiée sous le titre Angélique de Longueval) entre autres, qui fait partie du même volume, vous aurez la description exacte et fidèle de ces lieux qu'il affectionnait entre tous. Sylvie, Adrienne, sont deux noms qui sont souvent revenus dans ses œuvres dernières. Faut-il croire qu'il écrivait une autobiographie, lorsque, avec cette forme de Mémoires qui lui était familière, il écrivait comme lui étant personnelle l'histoire d'un jeune homme de la ville, amoureux et presque fiancé d'une jeune fille de la campagne, la délaissant ensuite dans un moment d'égarement, parce qu'au milieu d'une ronde villageoise il a aperçu la demoiselle du château, et que rien n'égale la beauté de celle-ci ? Puis quelques années s'écoulent sans qu'il reparaisse au village. Quand un hasard l'y ramène, il retrouve Sylvie ; mais l'autre, qu'est-elle devenue ? Ça a mal fini, lui répond-on tout bas. Il respecte cette discrétion. Il reste dans le doute et l'ignorance ; mais plus tard il croit, sous le feu de la rampe, reconnaître Adrienne dans une actrice à la mode. Il l'aime, il en est aimé.
Tout cela est-il vrai ? ou bien n'est-ce qu'une histoire, comme tant d'autres, où la réalité vient sans cess se mêler à la fiction ? Je ne sais. Toujours est-il que ces noms de Sylvie et d'Adrienne reviennent sans cesse sous la plume de Gérard de Nerval, qu'il ne pense qu'à elles en allant revoir son cher pays de Valois, et que jamais il n'a écrit le nom de Jenny Colon."
L'épisode de Jenny Colon, dont Bell dit qu'il le tient de Méry, mais qui lui a été confirmé par Nerval lui-même, peut-être au fond satisfait de cette légende construite autour de lui et qu'il ne veut pas démentir ; passion toute idéale, intervention maladroite des "amis", dénouement "vulgaire", vers écrits par Nerval sur ces moments heureux, tous disparus (ont-ils jamais existé ?), refus d'épouser l'actrice, rupture :
"Jenny Colon était une femme ravissamment belle, et certes, digne d'inspirer une semblable passion, si elle eût pu comprendre une nature aussi délicate et aussi exceptionnelle que celle de Gérard de Nerval 〈...〉 Tous les soirs, on était sûr de le rencontrer à la même place, à l'orchestre de l'Opéra-Comique. Là il savourait isolément toutes les délices de son adoration. D'une timidité d'enfant, rendue plus grande encore par l'état de son cœur, jamais il n'aurait osé aborder Jenny Colon et lui dire la passion qu'il ressentait 〈...〉
Cependant Gérard de Nerval était devenu sombre et taciturne. Tout ce qu'il éprouvait était précieusement concentré en lui-même. L'amitié s'inquiéta de le voir ainsi, et on surprit plutôt qu'on n'apprit son secret 〈...〉 Parmi ceux qui s'émurent vivement à la nouvelle de cet amour secret pour Jenny Colon, je dois nommer en première ligne Balzac, Méry, Dumas. Les rapports de collaboration qui existaient entre eux permirent à Dumas de sonder ce cœur malade. Il le fit un peu brutalement peut-être ; mais enfin il obtint un aveu. Dumas ne vit qu'un moyen de guérir son ami, un moyen qui l'aurait guéri lui-même en pareil cas. On connaissait les mœurs assez faciles de Jenny Colon ; on pouvait donc espérer de ne pas rencontrer de ce côté des obstacles trop rudes à vaincre. Méry s'unit à Dumas, et ensemble ils firent connaître à Jenny Colon l'amour qu'elle avait inspiré 〈...〉
Les allures timides, unies à une distinction naturelle qui caractérisaient Gérard de Nerval, plurent infiniment à Jenny Colon 〈...〉 Elle encouragea de son mieux cette timidité qui lui faisait entrevoir un bonheur inconnu jusqu'alors ; et l'on put tirer d'excellents augures de cette première rencontre. C'était compter sans Gérard de Nerval, c'était surtout bien mal le connaître. Rien de vulgaire ne pouvait entrer ni dans ses conceptions ni dans ses mœurs 〈...〉 il sentait que l'heure du dénoûment était proche, dénoûment vulgaire pour une passion si poétique 〈...〉
Cette heure arriva enfin, quoi que Gérard de Nerval fît pour la retarder encore. Jenny Colon était lasse d'être aimée ainsi. Elle n'avait jamais compris l'amour de la sorte, et aux amis conplaisants qui venaient lui parler des tourments et des inquiétudes de son amoureux, elle répondait : 'Mais que ne fait-il hardiment quelques pas de plus en avant ; je ne demande pas mieux.'
Un soir, après avoir joyeusement soupé en nombreuse compagnie, car l'état de son cœur n'empêchait pas Gérard de Nerval d'inviter ses amis et de les traiter splendidement, Jenny Colon, pétillante de verve, ravissante de beauté, enivrée, affolée presque par tout ce qui l'entourait, comprit que cet amour ne suivait pas la marche des amours ordinaires et qu'elle devait se donner à l'homme qui lui valait tous ces hommages, qui lui-même brûlait un encens si délicat à ses pieds. Elle prit Gérard de Nerval sous son bras, et, triomphante comme une reine, elle l'entraîna vers la chambre du lit, laissant tous ces convives illustres terminer leur nuit à table.
La possession, loin d'affaiblir la passion de Gérard de Nerval, ne fit au contraire que la rendre plus vive et plus tenace 〈...〉 Elle prit sur lui un empire immense. Fidèle dans son amour, comme nous l'avons tous connu fidèle dans ses amitiés, qui furent nombreuses, ardentes et choisies malgré cela, il ne concevait pas de plus grand bonheur que de travailler sans cesse en vue de celle qu'il aimait. Que de vers sortirent alors de cette tête inspirée par ce cœur ! Mais où sont-ils ? Quelques amis en ont bien conservé des lambeaux épars çà et là, le plus souvent confiés à la mémoire. Mais l'ensemble a disparu. Depuis longtemps Gérard de Nerval n'en parlait plus. Autant il se plaisait à nous réciter ces vers douloureux, enfantés dans les heures d'angoisses et comme pour nous montrer que la plaie était toujours vive et saignante dans son cœur, autant il mettait de retenue, je devrais dire de silence, à nous faire connaître les vers enfantés dans les moments heureux 〈...〉
Comment se rompit ce lien, comment s'opéra cette séparation ? C'est ce que nous devons dire, quoique l'histoire soit assez lamentable et commune à presque tous les amours d'élite.
Si Jenny Colon était admirablement belle, son intelligence, son cœur surtout, étaient loin d'être dignes de cette beauté. Nature de courtisane, elle ne comprenait guère dans l'amour que les jouissances matérielles, et cherchait en livrant son corps ce qu'il pouvait lui rapporter."
Enfin, Jenny Colon demande à Nerval de l'épouser :
"Bien des illusions de Gérard de Nerval tombèrent à ce mot. Il ne pouvait croire que son amour eût besoin, pour sa maîtresse, d'êre sanctionné par un lien légal 〈...〉 Il ne pouvait consentir à subir une loi dure qui ne lui présageait que tempêtes dans la vie commune. Il refusa, quitta sa maîtresse, et quelques jours après, Jenny Colon, devant l'officier municipal, changea son nom contre celui de madame Leplus."
Après la faillite du Monde dramatique, pressé par le besoin d'argent, Nerval multiplie les articles de presse, aux dépans de son inspiration ; la pente à la rêverie de Nerval :
"Notre poète sentit souvent l'aiguillon de la nécessité. Mais sa nature avait un tel besoin d'expansion et pouvait si peu produire en dehors de ses heures de liberté, que c'était alors surtout qu'il éprouvait une peine énorme à se mettre au travail. Ce même homme, qu'on trouvait d'ordinaire si plein d'exubérance et d'idées, était d'une stérilité pénible dans les moments de gêne. On eût dit que son cerveau se desséchait subitement ; un rien, une vétille l'arrêtait longtemps. L'imagination s'éteignait subitement, et il en était réduit à se promener des journées entières pour trouver dans la marche une excitation qui facilitât la génération de ses pensées. Dans ses courses, il ne voyait rien de ce qui se passait autour de lui. Il se perdait dans les foules, et trouvait de la sorte à s'isoler de manière à ne vivre qu'avec lui-même. L'ami qui le rencontrait alors et qui l'abordait était sûr de le déranger. Les premières paroles que lui ,adressait Gérard de Nerval ressemblaient toujours aux premières paroles qui échappent à un homme réveillé en sursaut. On l'avait réveillé en effet, mais du sommeil de sa rêverie. Que de fois, à l'époque assez récente encore où il publiait dans le National ses démarches pour trouver un livre rare, l'Histoire de l'abbé comte de Bucquoy, ne l'avons-nous pas rencontré ainsi ?"
Le voyage à Vienne et la crise de 1841 : Bell inverse ici la chronologie. Est-ce à dire qu'il y eut une crise avant le départ pour Vienne ? Bell l'évoque à nouveau quand il parle des retrouvailles à Marseille avec Méry, au retour d'Orient ; à Vienne, Nerval rencontre Marie Pleyel qui entreprend de le "guérir" :
"Le souvenir de Jenny Colon vivait toujours dans son cœur, et la pensée de cette femme, à force de fermenter dans sa tête, y porta un désordre maladif. Un instant ses amis conçurent des craintes sérieuses, mais bientôt, grâce aux soins affectueux et intelligents du docteur Blanche, les craintes disparurent, la santé revint, languissante d'abord, puis plus forte, enfin suffisante et capable de supporter un voyage, le remède le plus efficace pour les maladies de cette nature.
Gérard de Nerval, ayant chargé un de ses amis de régler toutes ses affaires et de ramasser tout ce qu’il pourrait sauver des débris de ses splendeurs passées, partit pour l'Allemagne, sa terre de prédilection. A peine le Rhin franchi, il se dirigea vers l'Autriche, qu'il ne connaissait pas encore, et arriva à Vienne au milieu de la plus brillante saison. Le nom de Gérard de Nerval était déjà fort populaire en Allemagne dans le monde des lettrés 〈...〉 Il y rencontra une femme que l'Europe entière connaît, et que je ne nommerai pas, parce qu'il suffit de dire qu'elle a partout recueilli le double hommage dû à la beauté de la femme et au talent de l'artiste pour que tout le monde la devine. Il trouva en elle tant de bienveillance unie à tant de grâce exquise, qu'il se crut sur le point d'aimer encore et d'oublier Jenny Colon. Sous l'empire de l'ancienne passion subitement réveillée, il écrivit à cette femme des lettres brûlantes qui la surprirent et excitèrent en elle le plus vif désir de connaître de plus près l'homme capable de peindre ainsi l'amour. Aux lettres, elle fit donc succéder les entretiens intimes. Hélas ! le rideau se déchira tout à coup. Gérard parlait à une femme de l'amour qu'il éprouvait pour une autre. En réalité, c'était à Jenny Colon qu'il avait écrit.
C'est au début d'Aurélia ou le Rêve et la vie, la dernière œuvre qu'ait achevée Gérard de Nerval, qu'il faut lire ces détails. Il aimait ainsi souvent à mettre dans ses livres les divers accidents de sa vie, partant de ce premier point de réalité pour arriver par des demi-teintes et des nuances effacées jusqu'aux limites les plus extrêmes de la fiction et de la fantaisie. Pour guérir son amour, il avait cru trouver une autre amoureuse. En réalité, elle ne fut qu'une amie et qu'une confidente. Elle comprit mieux que Gérard de Nerval lui-même ce qui se passait dans son cœur ; elle le poussa aux épanchements, et, quand elle eut obtenu des aveux complets, elle s'occupa de cicatriser cette plaie qui menaçait de rester éternellement vive. Les femmes ont toutes au fond de leur cœur un trésor de pitié et d'attentions douces qui les prédisposent volontiers au rôle de sœurs de charité. Elles accomplissent une mission de dévouement avec l'ardeur qui les porte au plaisir.
Gérard de Nerval, entouré de soins, au milieu de ce luxe qu'il aimait tant, retrouva quelques jours de tranquillité. Sa gaieté revint ; il se montra dans le monde et regarda Vienne avec un œil où la bonhomie avait peine à dissimuler la finesse de l'observateur."
Le grand succès des Amours de Vienne et la décision de "mettre un monde entre cette femme et lui" après avoir revu Jenny Colon à Bruxelles, décident Nerval à partir en Orient ; la maladie au Liban :
"Il partit pour l'Orient, pays de rêves dorés, au milieu desquels s'était souvent promenée son imagination. Il vit les îles grecques, l'Égypte, la Syrie, le Liban, Constantinople. Il chercha des aventures et en eut, car il voulut vivre à l'orientale ; un instant même, il eut la pensée de fixer sa vie dans ces contrées où l'homme jouit d'une grande indépendance individuelle, et peut-être, sans la maladie, aurait-il mis son projet à exécution. Mais la maladie vint le surprendre au moment où il choisissait sa demeure dans les montagnes habitées par les Druses, et pour recouvrer la santé, il fut envoyé à Constantinople. Au reste, qu'on reprenne son Voyage en Orient (2 vol. format in 18 anglais), on y retrouvera à peu près toute son histoire pendant cette lointaine pérégrination."
L'art de mélanger la vérité et la fiction, à propos du Voyage en Orient :
" J'ai dit la sensation profonde que fit parmi les littérateurs l'apparition des Amours de Vienne dans la Revue de Paris. Ces souvenirs d'Orient ne firent que confirmer et agrandir la renommée de Gérard de Nerval. C'est avec une habileté sans égale qu'il mêle le pronom personnel à tout ce qu'il raconte, d'après une méthode qu'il affectionnait et qu'il avait empruntée aux mémorialistes, dans tous les temps sa lecture favorite. Il trouvait aussi moyen de dissimuler adroitement la mise en scène qui est nécessaire à toute œuvre d'art. Dès les premières pages, il prenait, pour ainsi parler, le lecteur sous son bras, et l'entraînait avec lui sans lui dire où il l'entraînait, et cela d'une façon si naïve et si charmante, que volontiers le lecteur se laissait aller. De la sorte, Gérard de Nerval arrivait à tout exprimer sans jamais avoir effarouché par une allure trop brusque. On retrouve dans son style et dans sa manière de composer ce qui nous plaisait dans sa personne. A combien d'entre nous n'a-t-il pas dit des vérités qui nous auraient blessés de toute autre bouche que de la sienne ? Et nous l'écoutions cependant, et presque toujours, quand il avait fini de nous parler ainsi, nous étions prêts à suivre le conseil qu'il nous avait donné et à le remercier. Nous savions que rien de nuisible ne pouvait venir de lui, que jamais une pensée mauvaise n'avait traversé son cerveau. L'homme se montrait tout entier dans ce qu'il écrivait. Il osait dire, il osait faire adroitement des choses devant lesquelles tout autre aurait reculé. Sa conduite artistique ressemble en cela à sa conduite privée."
La première rencontre de Bell avec Nerval à Marseille, au retour d'Orient, son aspect physique, sa distinction alors :
"La première fois que j'ai vu Gérard de Nerval remonte à son retour d'Orient. Un paquebot le ramena à Marseille, que j'habitais alors, et avec lui nous rendit pour quelques mois le peintre Camille Rogier. Méry faisait les honneurs de sa ville natale à toutes les illustrations littéraires et artistiques que le hasard des voyages amenait sans cesse dans ce port 〈...〉
Depuis longtemps déjà Gérard de Nerval était lié avec Méry d'une de ces amitiés sympathiques que l'absence et l'éloignement rendent plus chères encore. Pendant un de ses séjours en Allemagne, Gérard avait passé pour mort, et M. J. Janin avait même écrit un long article nécrologique qu'on peut retrouver encore en tête de Lorely. Méry, n'habitant plus Paris qu'à de rares intervalles, n'avait eu que d'assez vagues nouvelles de son ami. Ce fut donc avec un vrai sentiment de bonheur qu'il reçut sa première visite at retour d'Orient. Il le conduisit le soir dans le salon qu'une noble dame, aussi remarquable par sa beauté que par la distinction de son esprit, avait la bonté d'ouvrir à nos causeries intimes, et c'est là que je le vis.
Gérard de Nerval avait alors une tête admirable et par la douceur du regard et par l'expression intelligente de la physionomie. Le soleil d'Orient avait légèrement hâlé la peau. Le teint était d'une pâleur mate. Les cheveux se faisaient déjà rares, et une courte barbe descendait en pointe jusque sous le menton. Au reste, toutes les manières et toute la tenue d'un gentilhomme, habitué dès l'enfance aux élégances de la haute vie, l'auraient fait distinguer entre tous dès le premier abord. Il produisit un grand effet sur toute la société au milieu de laquelle il était conduit, effet d'autant plus vif que Méry, quelques jours auparavant, nous avait raconté ses amours avec Jenny Colon. C'est par Méry que j'ai su la plupart des détails mentionnés dans mon récit. Il est vrai que plus tard, lorsque la sympathie première se transforma en amitié de tous les instants, ils m'ont été confirmés par Gérard de Nerval lui-même, et dès lors, j'ai dû croire à leur scrupuleuse exactitude."
Regain d'activité pour le théâtre après 1848 ; Bocage dirige l'Odéon, Marc Fournier la Porte-Saint-Martin ; collaboration avec Méry pour Le Chariot d'enfant et L'Imagier de Harlem :
" Mais ces tendances théâtrales ne devaient trouver à s'épanouir librement qu'après la Révolution de 1848. Quelque temps après ce grand événement politique l'éminent acteur Bocage avait repris la direction du théâtre de l'Odéon. Bocage, voulant faire de l’art, s'entoura naturellement des écrivains qui depuis vingt ans honoraient la langue française, et que la scène avait eu le tort de trop négliger jusque-là. Méry, Gérard de Nerval, George Sand, furent les premiers appelés. Bocage abandonnait son théâtre à ces esprits d'élite, laissant libre carrière à leur fantaisie et n'intervenant que pour faire interpréter leurs œuvres de façon digne d'eux et de lui. Il était sûr que, de la sorte, le public distingué, qui ne manque jamais à Paris, prendrait l'habitude de s'acheminer vers l'Odéon, et que bientôt la fortune suivrait le public.
Un semblable directeur était celui qu'avait toute sa vie rêvé Gérard de Nerval. Sa tête était pleine d'idées glorieuses pour l'art dramatique français. Depuis longtemps, il nourrissait le désir de faire connaître les chefs-d'œuvre des théâtres orientaux, dont l'antiquité laisse loin derrière elle le théâtre grec. Au frontispice du Monde dramatique, ⎼ un chef-d'œuvre de Célestin Nanteuil, ⎼ tout en haut, sur la gauche, est dessinée une scène de l'Orphelin de la famille de Tchao, pièce chinoise, et comme pendant, sur la droite, une scène empruntée au Chariot de Terre cuite, une des plus belles scènes du théâtre indien. Dans le cours du recueil, et notamment tome I, pages 43, 81, et 416, sont citées plusieurs scènes de ce drame. Gérard de Nerval a passé sa vie à mettre en œuvre les idées qu'il avait conçues dès sa première jeunesse. Il est incontestable pour nous que, dès ce temps du Monde dramatique (1835), il rêvait de faire paraître sur notre scène des pièces indiennes et chinoises. Mais, pour arriver à ce but, il fallait qu'un directeur se mît à sa disposition. Bocage fut ce directeur, et cela nous a valu le Chariot d'enfant que Gérard de Nerval arrangea et mit en vers, avec la collaboration de Méry.
Cette collaboration était admirablement choisie et promettait de devenir féconde. Nature souple, talent facile entre tous, Méry, par cette souplesse même, donnait du ressort à Gérard de Nerval lorsque celui-ci menaçait de se laisser arrêter par des embarras inextricables. Ensemble, deux ans après le Chariot d'enfant, ils ont fait, pour inaugurer la direction de Marc Fournier au théâtre de la Porte-Saint-Martin, un drame immense et qui aurait dû accueillir le plus grand succès. Venu en d'autres temps, l'Imagier de Harlem aurait pu opérer une révolution littéraire.
Gérard de Nerval avait fondé de grandes espérances sur cette pièce, qui lui rappelait le Faust traduit dans sa jeunesse, mais Faust abandonnant les hautes sphères scientifiques pour ne se livrer qu'à l'industrie. Ces espérances furent loin d'être réalisées. La mise en scène du drame avait exigé des dépenses considérables, et une administration nouvelle craignit de s'aventurer en soutenant énergiquement cette pièce quand les recettes commencèrent à fléchir. Ce fut un rude coup pour Gérard de Nerval. Depuis quelque temps il se sentait malade, et confiait à notre amitié les craintes sérieuses qu'il commençait à concevoir pour l'avenir."
1852-1853, l'envahissement progressif par la rêverie, l'amitié indéfectible de Georgs Bell qui accompagne Nerval dans ses promenades aux environs de Paris :
"Le mal physisque s'empara le premier de Gérard de Nerval. Pendant qu'on jouait encore l'Imagier de Harlem, un soir, chez son excellent ami Eugène de Stadler, il se trouva subitement pris de douleurs à la tête si intenses, que l'alarme se répandit bientôt parmi nous. Un instant nous craignîmes de le perdre. Nous en fûmes quittes pour la peur ; mais il lui resta de cette première atteinte une lourdeur d'esprit qui l'inquiétait plus encore que la maladie. Le travail lui était devenu mpossible. Et c'était pour lui un tourment d'autant plus insupportable, qu'en ce moment même la librairie allait publier deux volumes de lui, les Illuminés, dans lesquels il faisait entrer divers articles biographiques et critiques publiés une première fois dans les Revues 〈...〉, et Lorely, dans lequel il avait rassemblé les souvenirs de ses divers voyages en Allemagne et d'un voyage récent en Hollande. En même temps sa pensée allait sans cesse chercher dans les années antérieures les bonheurs évanouis. Il vivait comme dans un rêve perpétuel, au milieu de fantômes et de chimères qui lui plaisaient d'autant plus qu'ils revêtaient des formes plus idéales. J'étais devenu son confident. Avec moi, dans ces heures pénibles, il ne craignait pas de mettre à découvert ce qui se passait dans l'intimité de son esprit. J'entrepris de le guérir, et, comme la belle saison était revenue, nous nous mîmes à faire de longues promenades, qui parfois duraient plusieurs jours, dans les environs de Paris. Gérard de Nerval, dans son dernier ouvrage, Aurélia ou le Rêve et la vie, a consacré lui-même le souvenir de cette cure entreprise par l'amitié. Pendant que nous allions ainsi, presque toujours à travers bois, à Meudon, à Sèvres, à Saint-Cloud, à Versailles, à Saint-Germain, j'essayai de faire renaître ces ardeurs qui donnent des forces pour le travail. Quand Gérard me rappelait ou les souvenirs de son enfance, ou ceux de son amour, j'évitais avec soin de le laisser se perdre dans le rêve et lui vantais sans cesse la puissance de la réalité en littérature. Peu à peu, il sortit de sa torpeur, et, pour satisfaire une promesse antérieure à sa maladie, il écrivit, pour la Revue des Deux Mondes, toujours friande de sa prose, Sylvie, une des œuvres les plus délicates qui soient sorties de sa plume."
Nouvelle crise, internement chez Émile Blanche à Passy, témoignage de fidélité des amis ou se disant tels, dernier voyage en Allemagne :
" Cependant ce n'était qu'un repos de quelques mois accordé par la maladie. Le moindre accident pouvait occasionner une rechute. Cet accident fut la mort du poète Charles Reynaud. Gérard de Nerval l'avait connu ; il voulut lui rendre les derniers devoirs. Mais sa raison ébranlée ne put supporter la vue de la chambre mortuaire et des lieux où il avait naguère rencontré la vie et la gaieté. Je le vis dans la soirée, et je compris à ses paroles qu'il lui fallait encore les plus grands soins et les plus grands ménagements. Un médecin bien connu des littérateurs et des artistes, le docteur Blanche, depuis longtemps ami de Gérard, nous offrit sa maison de santé, et nous y installâmes notre ami au milieu des fleurs rares et des arbres exotiques qui décorent encore cet antique domaine de l'infortunée princesse de Lamballe.
Durant les deux années que Gérard de Nerval a passées dans cette maison, la maladie lui a rarement permis de travailler ; mais elle lui a du moins fait connaître quelle affection vive lui portait presque toute la littérature contemporaine 〈...〉 Mais, quand la santé paraissait revenir, les inquiétudes revenaient avec elle. Gérard se montrait soucieux de l'avenir ; il voulait travailler désormais uniquement en prévision de la valeur future de ses œuvres. Aussi tout ce qu'il écrivait était loin de le satisfaire. Son esprit roulait dans un cercle d'idées toutes personnelles dont il se défiait 〈...〉 Toute la correspondance de Gérard de Nerval, à cette époque, est empreinte de mélancolie et de tristesse. Il ne reprit un peu de sérénité que durant un dernier et court voyage qu'il fit en Allemagne l'été dernier."
La fin tragique ; pour Bell cependant, Nerval a été très entouré par ses amis jusqu'au bout :
" Gérard de Nerval nous revint en effet de ce voyage tout ragaillardi, plein de verve et de gaieté. Mais Paris l'attendait, avec ses ennuis, ses inquiétudes, ses anxiétés, et cette fois sa proie vivante ne devait plus lui échapper. Gérard de Nerval essaya vainement de lutter par le travail ; sa tête se rebellait à la pensée d'écrire au jour le jour. Il lui fallait la rêverie pour produire, et la rêverie, c'était le mal dont il devait mourir. Malgré lui, d'ailleurs, ses rêves se portaient vers les bonheurs enfuis pour toujours 〈...〉 Sa dernière œuvre, qui restera inachevée, Aurélia, nous fait voir toutes les tortures, toutes les angoisses de ce cerveau endolori. L'amitié, aux heures de découragement, faisait de vains efforts pour rattacher les fils rompus de cette existence brisée. Rien ne pouvait détourner le dénoûment fatal.
A l'heure de sa mort, Gérard de Nerval était plus aimé, plus recherché que jamais. Aux amitiés anciennes chaque jour avait ajouté des amitiés nouvelles, jeunes, ardentes, vivaces. Tout ce qui sortait de cette plume était par nous tous recherché avec avidité. La Revue de Paris et l'Illustration ont eu ses dernières pages, et pas un d'entre nous qui ne les ait connues et dévorées dès le jour de leur parution.
En même temps, Gérard de Nerval s’occupait aussi de théâtre. La Comédie-Française mettait en répétition sa traduction de Misanthropie et Repentir, et Arsène Houssaye lui préparait encore de nouveaux travaux. D'autre part, avec Auguste Maquet, ⎼ encore une amitié de vingt-cinq ans ! ⎼ il voulait faire un drame-féerie de la Main de gloire, et il était en pourparlers avec Marc Fournier pour une autre pièce de la Porte-Saint-Martin. Enfin il ramassait toujours les matériaux d'un grand ouvrage sur le Paris nocturne qu'il rêvait depuis plusieurs années, et c'est pour cela qu'on le rencontrait souvent du côté des Halles, dont il connaissait les moindres recoins. L'avenir semblait donc se montrer sous d'heureux auspices, et cependant, par une froide nuit de janvier, cette existence allait être close brutalement."
______