GÉRARD DE NERVAL - SYLVIE LÉCUYER tous droits réservés @
CE SITE / REPÈRES BIOGRAPHIQUES / TEXTES / NOTICES / BELLES PAGES / MANUSCRITS AUTOGRAPHES / RECHERCHES AVANCÉES
NOTICES
« Les images de deuil et de désolation qui ont entouré mon berceau »
La Généalogie fantastique, Labrunie et Bonaparte, qui suis-je
les Dublanc
les Labrunie
les Paris de Lamaury
les Olivier
les Boucher
les Laurent
Carte des itinéraires valoisiens de Nerval
Le temps vécu de la petite enfance (1810-1815)
Le clos Nerval
L’oncle Antoine Boucher
Voix et Chansons
Les plaisirs et les jeux
Le temps des retours en Valois (1850-1854):
Le Valois transfiguré: Aurélia
Promenades en Valois, diaporama
LES ANNÉES CHARLEMAGNE
Père et fils rue Saint-Martin
Les cahiers de poésies de 1824
Le collège Charlemagne
Satiriste, anticlérical et anti-ultra
Auteur à 17 ans chez Ladvocat et Touquet
Pseudonyme Beuglant
LA CAMARADERIE DU PETIT CÉNACLE
1830, les Trois Glorieuses
Se rallier à Victor Hugo
L’atelier de Jehan Duseigneur
Traduire les poètes allemands
« En ce temp, je ronsardisais »
« Arcades ambo »
Jenny Colon
Le Monde dramatique
Le choix du nom de Nerval
La fin du Doyenné
L’expérience napolitaine:
Un Roman à faire
Octavie
Le Temple d’Isis. Souvenir de Pompéi
Élaboration fantasmatique et poétique:
A J-y Colonna
El Desdichado
Delfica
Myrtho
LE VOYAGE EN ALLEMAGNE DE 1838
« La vieille Allemagne notre mère à tous, Teutonia ! »
De Strasbourg à Baden et de Baden à Francfort
Les quatre lettres de 1838 au Messager
Les trois lettres de 1840 dans La Presse
Retour à Paris. Léo Burckart, heurs et malheurs du « beau drame allemand »
Les deux Léo Burckart
Espoir de reconnaissance et humiliation
Diplomate ou bohème?
Les Amours de Vienne
L’expérience viennoise fantasmée
Les Amours de Vienne. Pandora
Schönbrunn, belle fontaine et Morte fontaine
Décembre 1840 à Bruxelles
Les journées de février-mars 1841 à Paris
Les feuillets Lucien-Graux
Lettres à Bocage, Janin et Lingay
Hantise du complot
Éblouissement poétique:Lettres à Victor Loubens et à Ida Ferrier
Les sonnets « à Muffe »
L’itinéraire de Paris vers l’Orient: Marseille et Trieste
Le compagnon de voyage Joseph de Fonfrède
Escales dans l’Archipel grec :
Cythère
Syra
Visite aux pyramides
Adoniram et Balkis, Les Nuits du Ramazan :
Le projet de 1835
Le récit du conteur
Échos psychiques et littéraires
LE REGARD DES AUTRES
JULES JANIN (1804-1874)

Jules Janin a su se faire connaître très tôt comme feuilletoniste. Bien introduit dans les milieux littéraires, il a fait rencontrer à Nerval débutant le journaliste Laurentie et le directeur de théâtre Harel. Entré au Journal des Débats en 1829, il y tient la Chronique des Lundis. La rumeur se répand vite de l’état psychique dans lequel se trouve Nerval en février 1841, et les commentaires vont bon train. Le plus assassin fut sans doute celui de Jules Janin, dans un article intitulé : Gérard de Nerval, éternelle revanche des médiocres, véritable « épitaphe » de l'esprit de son prétendu ami. Ulcéré par le ton et par le contenu de la prose de Janin, Nerval lui répondra : « De sorte, mon cher Janin, que je suis le tombeau vivant du Gérard de Nerval que vous avez aimé, produit et encouragé si longtemps », et le citera tout au long onze ans plus tard dans la préface de Lorely pour lui en faire reproche.
******
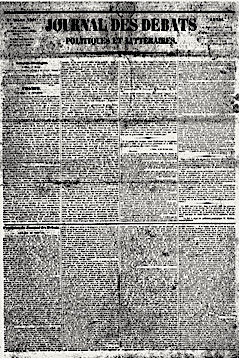
GÉRARD DE NERVAL.
« Ceux qui l’ont connu pourraient dire au besoin toute la grâce et toute l’innocence de ce gentil esprit qui tenait si bien sa place parmi les beaux esprits contemporains. Il avait à peine trente ans, et il s’était fait, en grand silence, une renommée honnête et loyale, qui ne pouvait que grandir. C’était tout simplement, mais dans la plus loyale acception de ce mot-là : la poésie, un poète, un rêveur, un de ces jeunes gens sans fiel, sans ambition, sans envie, à qui pas un bourgeois ne voudrait donner en mariage même sa fille borgne et bossue ; en le voyant passer le nez au vent, le sourire sur la lèvre, l’imagination éveillée, l’œil à demi fermé, l’homme sage, ce qu’on appelle des hommes sages, se dit en lui-même : — Quel bonheur que je ne sois pas fait ainsi ! Vous auriez mis celui-ci au milieu d’une élection quelconque, que pas un électeur ne lui eût donné sa voix pour en faire le troisième adjoint à M. le maire ; dans la garde nationale, tout ce qu’il eût pu jamais espérer, c’eût été d’être nommé caporal par dérision et avec le consentement de son épicier, de son bottier ou de son marchand de bois. Mais de tous les honneurs de ce monde il ne s’inquiétait guère, le pauvre enfant.
Il vivait au jour le jour, acceptant avec reconnaissance, avec amour, chacune des belles heures de la jeunesse, tombées du sein de Dieu. Il avait été riche un instant, mais par goût, par passion, par instinct, il n’avait pas cessé de mener la vie des plus pauvres diables. Seulement il avait obéi plus que jamais au caprice, à la fantaisie, à ce merveilleux vagabondage dont ceux-là même qui l’ignorent disent tant de mal. Au lieu d’acheter avec son argent de la terre, une maison, un impôt à payer, des droits et des devoirs, des soucis, des peines et l’estime de ses voisins les électeurs, il avait acheté des morceaux de toiles peintes, des fragmens de bois vermoulu, toutes sortes de souvenirs des temps passés, un grand lit de chêne sculpté de haut en bas ; mais le lit acheté et payé, il n’avait plus eu assez d’argent pour acheter de quoi le garnir, et il s’était couché, non pas dans son lit, mais à côté de son lit, sur un matelas d’emprunt. Après quoi, toute sa fortune s’en était allée pièce à pièce, comme s’en allait son esprit, causerie par causerie, bons mots par bons mots ; mais une causerie innocente, mais des bons mots sans malice et qui ne blessaient personne. Il se réveillait en causant le matin, comme l’oiseau se réveille en chantant, et en voilà pour jusqu’au soir. Chante donc, pauvre oiseau sur la branche ; chante et ne songe pas à l’hiver : — laisse les soucis de l’hiver à la fourmi qui rampe à tes pieds.
Il serait impossible d’expliquer comment cet enfant, car, à tout prendre, c’était un enfant, savait tant de choses sans avoir rien étudié, sinon au hasard, par les temps pluvieux, quand il était seul, l’hiver, au coin du feu. Toujours est-il qu’il était très versé dans les sciences littéraires. Il avait deviné l’antiquité, pour ainsi dire, et jamais il ne s’est permis de blasphème contre les vieux dieux du vieil Olympe ; au contraire, il les glorifiait en mainte circonstance, les reconnaissant tout haut pour les vrais dieux, et disant son mea culpa de toutes ses hérésies poétiques. Car, en même temps qu’il célébrait Homère et Virgile, comme on raconte ses visions dans la nuit, comme on raconte un beau songe d’été, il allait tout droit à Shakspeare, à Goëthe surtout, si bien qu’un beau matin, en se frottant les yeux, il découvrit qu’il savait la langue allemande dans tous ses mystères, et qu’il lisait couramment le drame du docteur Faust. Vous jugez de son étonnement et du nôtre. Il s’était couché la veille presque Athénien, il se relevait le lendemain un Allemand de la vieille roche. Il acceptait non seulement le premier, mais encore le second Faust ; et cependant nous autres, nous lui disions que c’était bien assez du premier. Bien plus, il a traduit les deux Faust, il les a commentés, il les a expliqués à sa manière ; il voulait en faire un livre classique, disait-il. Souvent il s’arrêtait en pleine campagne, prêtant l’oreille, et dans ces lointains lumineux que lui seul il pouvait découvrir, vous eussiez dit qu’il allait dominer tous les bruits, tous les murmures, toutes les imprécations, toutes les prières, venus à travers les bouillonnemens du fleuve, de l’autre côté du Rhin.
Si jeune encore, comme vous voyez, il avait eu toutes les fantaisies, il avait obéi à tous les caprices. Vous lui pouviez appliquer toutes les douces et folles histoires qui se passent, dit-on, dans l’atelier et dans la mansarde, tous les joyeux petits drames du grenier où l’on est si bien à vingt ans, et encore c’eût été vous tenir un peu au-delà de la vérité. Pas un jeune homme, plus que lui, n’a été facile à se lier avec ce qui était jeune et beau et poétique ; l’amitié lui poussait comme à d’autres l’amour, par folles bouffées ; il s’enivrait du génie de ses amis comme on s’enivre de la beauté de sa maîtresse ! Silence ! ne l’interrogez pas ! où va-t-il ? Dieu le sait ! à quoi rêve-t-il ? que veut-il ? quelle est la grande idée qui l’occupe à cette heure ? respectez sa méditation, je vous prie, il est tout occupé du roman ou du poème et des rêves de ses amis de la veille. Il arrange dans sa tête ces turbulentes amours ; il dispose tous ces événemens amoncelés ; il donne à chacun son rêve, son langage, sa joie ou sa douleur. — Eh bien ! Ernest, qu’as-tu fait ? Moi, j’ai tué cette nuit cette pauvre enfant de quinze ans, dont tu m’as conté l’histoire. Mon cœur saigne encore, mon ami, mais il le fallait ; cette enfant n’avait plus qu’à mourir ! — Et toi, cher Auguste, qu’as-tu fait de ton jeune héros que nous avons laissé dans la bataille philosophique ? Si j’étais à ta place, je le rappellerais de l’Université, et je lui donnerais une maîtresse. Tel[le]s étaient les grandes occupations de sa vie : marier, élever, accorder entre eux toutes sortes de beaux jeunes gens, tout frais éclos de l’imagination de ses voisins ; il se passionnait pour les livres d’autrui bien plus que pour ses propres livres ; quoi qu’il fît, il était tout prêt à tout quitter pour vous suivre. — Tu as une fantaisie, je vais me promener avec elle, bras dessus, bras dessous, pendant que tu resteras à la maison, à te réjouir ; et quand il avait bien promené votre poésie, çà et là, dans les sentiers que lui seul il connaissait, au bout de huit jours, il vous la ramenait, calme, reposée, la tête couronnée de fleurs, le cœur bien épris, les pieds lavés dans la rosée du matin, la joue animée au soleil de midi. Ceci fait, il revenait tranquillement à sa propre fantaisie qu’il avait abandonnée, sans trop de façon, sur le bord du chemin. Cher et doux bohémien de la prose et des vers ! admirable vagabond dans le royaume de la poésie ! braconnier sur les terres d’autrui, mais il abandonnait à qui les voulait prendre les beaux faisans dorés qu’il avait tués !
Il avait toujours besoin de suivre quelqu’un. Il se donnait volontiers au premier venu qui le voulait emmener en laisse ; seulement, au premier sentier qui lui plaisait, il vous plantait là, la laisse à la main. C’est ainsi qu’un jour il suivit dans un de ses voyages un des gros bonnets de la littérature, un homme bien posé, avec signature ayant cours à la bourse littéraire ; le gros bonnet allait naturellement à cheval ou en voiture, attirant toute l’attention et tout le sourire des belles dames du chemin, pendant que notre épagneul allait à pied, gravissant les montagnes au pas de course. Nul ne remarquait l’épagneul, ni son petit jappement plein de gaîté, ni son bel œil fin et railleur, ni sa légèreté de chamois. Eh bien ! quand chacun fut de retour de ce voyage, l’épagneul avant le maître qui était resté à se faire applaudir dans un des treize cantons, l’épagneul se mit à japper gaiement ce qu’il avait vu et entendu dans son voyage ; or, il avait tout vu, tout entendu, tout admiré, il savait sa route par cœur ; il avait retrouvé dans ces frais sentiers les fumées légères de tous les amours. Tout cela fut raconté en vingt-cinq ou trente pages ravissantes ; et lorsqu’enfin revint à son tour le gros bonnet, tout rempli de gros volumes, il se trouva que l’épagneul avait tout dit.
Une autre fois il voulut voir l’Allemagne, qui a toujours été son grand rêve. Il proposa à je ne sais plus quel ministre intelligent (il y en a) d’aller à Vienne pour y faire des découvertes. Quelles découvertes ? Le ministre n’en savait rien, ni lui non plus. Mais enfin, à coup sûr, en cherchant bien, on devait trouver quelque chose. — D’ailleurs, disait-il, j’ai un grand avantage : je ne suis pas élève de l’École des Chartes, je n’ai jamais eu de prix à l’Institut ; je ne suis pas un homme spécial, il est donc impossible que je ne trouve pas quelque chose. Et puis il demandait si peu ! Bon. Il part ; il arrive à Vienne par un beau jour pour la science : par le carnaval officiel et gigantesque qui se fait là-bas. Lui, alors, il fut tout étonné et tout émerveillé de sa découverte. Quoi ! une ville en Europe où l’on danse toute la nuit, où l’on boit tout le jour, où l’on fume le reste du temps de l’excellent tabac. Quoi ! une ville que rien n’agite, ni les regrets du passé, ni l’ambition du jour présent, ni les inquiétudes du lendemain ! une ville où les femmes sont belles sans art, où les philosophes parlent comme des poètes, où les poètes pensent comme des philosophes, où personne n’est insulté, pas même l’Empereur, où chacun se découvre devant la gloire, où rien n’est bruyant, excepté la joie et le bonheur ! Voilà une merveilleuse découverte. Notre ami ne chercha pas autre chose. Il disait que son voyage avait assez rapporté. Son enthousiasme fut si grand et si calme qu’il en fut parlé à M. de Metternich. M. de Metternich voulut le voir et le fit inviter à sa maison pour tel jour. Il répondit à l’envoyé de S. A. qu’il était bien fâché, mais que justement ce jour-là il allait entendre Strauss qui jouait avec tout son orchestre une valse formidable de Liszt, et que le lendemain il devait se trouver au concert de Madame Pleyel, qu’il devait conduire lui-même au piano, mais que le surlendemain, il serait tout entier aux ordres de S. A. En conséquence, il ne fut qu’au bout d’un mois chez le prince. Il entra doucement sans se faire annoncer ; il se plaça dans un angle obscur, regardant toutes choses et surtout les belles dames ; il prêta l’oreille sans mot dire à l’élégante et spirituelle conversation qui se faisait autour de lui, il n’eut de contradiction pour personne ; — il ne se vanta ni des chevaux qu’il n’avait pas, — ni de ses maisons imaginaires, — ni de son blason, — ni de ses amitiés illustres ; — il se donna bien garde de mal parler des quelques hommes d’élite dont la France s’honore encore à bon droit. — Bref, il en dit si peu et il écouta si bien, que M. de Metternich, demandait à la fin de la soirée quel était ce jeune homme blond, bien élevé, si calme, au sourire si intelligent et si bienveillant à la fois, et quand on lui eut répondu : — C’est un homme de lettres français, Monseigneur ! M. de Metternich, tout étonné, ne pouvait pas revenir d’une admiration qui allait jusqu’à la stupeur.
Ainsi il serait resté à Vienne toute sa vie peut-être ; mais le ministère changea, fut remplacé par un autre ministère ; notre envoyé littéraire fut rappelé, et il revint de l’Allemagne en donnant toutes sortes de louanges à cette vie paisible, studieuse et cependant enthousiaste et amoureuse, qu’il avait partagée. Le sentiment de l’ordre, uni à la passion, lui était venu en voyant réunis tout à la fois tant de calme et tant de poésie. Il avait bien mieux fait que de découvrir dans la poussière des bibliothèques quelques vieux livres tout moisis qui n’intéressent personne ; il avait découvert comment la jeune Allemagne, si fougueuse et si terrible, initiée à toutes les sociétés secrètes, qui s’en va le poignard à la main, marchant incessamment sur les traces sanglantes du jeune Sand, quand elle a enfin jeté au dehors toute sa fougue révolutionnaire, s’en revient docilement à l’obéissance, à l’autorité, à la famille, à l’ordre enfin. — Double phénomène qui a sauvé l’Allemagne et qui la sauve encore aujourd’hui. — Toujours est-il que notre ami se mit à songer sérieusement à ce curieux miracle, dont pas une nation moderne ne lui offrait l’analogie, à toute cette turbulence et à tout ce sang-froid, et que de cette pensée-là, longtemps méditée, résulta un drame, un beau drame sérieux, solennel, complet. Mais vous ne sauriez croire quel fut l’étonnement universel quand on apprit que ce rêveur, ce vagabond charmant, cet amoureux sans fin et sans cesse, écrivait quoi ? Un drame ! lui, un drame où l’on parle tout haut, où l’on aime tout haut, un drame tout rempli de trahisons, de sang, de vengeances, de révoltes ? Allons donc, vous êtes dans une grave erreur, mon pauvre homme. Moi qui vous parle, pas plus tard qu’hier j’ai rencontré Gérard dans la forêt de Saint-Germain, à cheval sur un âne qui allait au pas. Il ne songeait guère à arranger des coups de théâtre, je vous jure ; il regardait tout à la fois le soleil qui se couchait et la lune qui se levait, et il disait à celui-là. — Bonjour Monsieur ! — À celle-là : — Bonne nuit, Madame ! Pendant ce temps, l’âne heureux broutait le cytise en fleurs.
Et comme il avait dit, il devait faire. Tout en souriant à son aise, tout en vagabondant selon sa coutume, et sans quitter les frais sentiers non frayés qu’il savait découvrir, même au milieu des turbulences contemporaines, il vint à bout de son drame. Rien ne lui coûta pour arriver à son but solennel. Il avait disposé sa fable d’une main ferme, il avait écrit son dialogue d’un style éloquent et passionné ; il n’avait reculé devant pas un des mystères du carbonarisme allemand, seulement il les avait expliqués et commentés avec sa bienveillance accoutumée. Voilà tout son drame tout fait ! Alors il se met à le lire, il se met à pleurer, il se met à trembler, tout comme fera le parterre plus tard. Il se passionne pour l’héroïne qu’il a faite si belle et si touchante ; il prend en main la défense de son jeune homme, condamné à l’assassinat par le fanatisme ; il prête l’oreille au fond de toutes ces émotions souterraines pour savoir s’il n’entendra pas retentir quelques accens égarés de la muse belliqueuse de Koerner. Si bien qu’il recula le premier devant son œuvre. Une fois achevée, il la laissa là parmi ses vieilles lames ébréchées, ses vieux fauteuils sans dossiers, ses vieilles tables boiteuses, tous ces vieux lambeaux entassés çà et là avec tant d’amour, et que déjà recouvrait l’araignée de son transparent et frêle linceul. Ce ne fut qu’à force de sollicitations et de prières, que le théâtre put obtenir ce drame, intitulé Léo Burckard [sic]. Il ne voulait pas qu’on le jouât. Il disait que cela lui brisait le cœur de voir les enfans de sa création exposés sur un théâtre, et il se lamentait sur la perte de l’idéal. De l’huile, disait-il, pour remplacer le soleil ! Des paravens, pour remplacer la verdure ; la première venue qui usurpe le nom de ma chaste jeune fille, et pour mon héros un grand gaillard en chapeau gris qu’il faut aller chercher à l’estaminet voisin ! Bref, toutes les peines que se donnent les inventeurs ordinaires pour mettre leurs inventions au grand jour, il se les donnait, lui, pour garder les siennes en réserve. Le jour de la première représentation de Léo Burckard, il a pleuré. — Au moins, disait-il, si j’avais été sifflé, j’aurais emporté ces pauvres êtres dans mon manteau ; eux et moi, nous serions partis à pied pour l’Allemagne, et une fois là, nous aurions récité en chœur le super flumina Babylonis ! Il avait ainsi à son service toutes sortes de paraboles et de consolations ; il savait ainsi animer toutes choses, et leur prêter mille discours pleins de grâce et de charme ; mais il faudrait avoir dans l’esprit un peu de la poésie qu’il avait dans le cœur, pour vous les raconter.
Je vous demande pardon si je vous écris, un peu au hasard, cette heureuse et modeste biographie ; mais je vous l’écris comme elle s’est faite, au jour le jour, sans art, sans préparation aucune, sans une mauvaise passion, sans un seul instant d’ambition ou d’envie. Un enfant bien né, et naturellement bien élevé, qui serait enfermé dans quelque beau jardin des hauteurs de Florence, au milieu des fleurs, et tenant sous ses yeux tous les chefs-d’œuvre amoncelés, n’aurait pas de plus honnêtes émotions et de plus saints ravissemens que le jeune homme dont je vous parle. Seulement il faisait naître les fleurs sur son passage, c’est-à-dire qu’il en voyait partout ; et, quant aux chefs-d’œuvre, il avait la vue perçante, il en savait découvrir sur la terre et dans le ciel. Il devinait leur profil imposant dans les nuages, il s’asseyait à leur ombre ; il savait si bien les décrire qu’il vous les montrait lui-même souvent plus beaux que vous ne les eussiez vus de vos yeux. Tel il était ; et si bien que pas un de ceux qui l’ont connu ne se refuserait à ajouter quelque parole amie à cet éloge, qui est plus qu’un éloge posthume, — bien plus triste cent fois, et bien plus solennel ; et dont nous devons tous retirer quelque enseignement salutaire, si nous sommes sages, nous d’abord, lui ensuite, quand au premier printemps, tout à l’heure peut-être (ne sentez-vous pas le soleil ? n’entendez-vous pas les lilas grandir ?), il reviendra à la raison.
Car voici ce qui est arrivé, l’autre jour ici même, à la place où je vous écris, nous étions réunis trois à quatre et Gérard était là, causeur comme il ne l’avait jamais été. Surtout ce qui l’intéressait depuis tantôt trois mois qu’il était revenu de la Belgique, c’était cette grande question de la propriété littéraire. Il s’en était occupé avec l’ardeur silencieuse et constante qu’il portait en toutes choses ; il l’avait arrangée comme il avait arrangé son drame, et maintenant il rapportait, disait-il, un projet sans réplique. — C’en était fait, à l’entendre, de la contrefaçon belge. – Tout livre français allait passer de France non seulement en Belgique, mais dans toute l’Allemagne, dans toute l’Italie, et jusqu’au fond de la Russie. — À peine s’il comptait les censeurs pour un obstacle. Quant à son plan, il ne le disait pas encore, il le gardait en réserve jusqu’à ce que la Chambre des Députés eût bien pataugé dans cette loi nouvelle dont elle ne sait pas le premier mot. — Mais, lui disait-on, de bonne foi, trouvez-vous que la contrefaçon belge, et en général la contrefaçon, fasse grand tort à l’écrivain ? Pour un peu d’argent qu’il y perd, il y gagne une popularité immense ; son nom et sa gloire, s’il y a gloire, protégés par ces livres à bon marché, s’en vont çà et là dans les recoins les plus inaccessibles de l’Europe lettrée ; c’est à la contrefaçon surtout que la langue française devra quelque jour son universalité. Vous parlez de droits d’auteur ? Qu’importe le droit de l’auteur sur l’argent des peuples voisins, pourvu qu’il ne perde pas son droit à leur admiration, à leur estime ? Que fait l’argent en cette affaire ? De quel droit faire de la poésie, de l’histoire, du drame, des chefs-d’œuvre du peintre, du musicien ou du sculpteur, une misérable et stérile question d’argent ? Ne sommes-nous pas, à tout prendre, la nation française, c’est-à-dire la souveraine toute puissante des belles-lettres et des beaux-arts en Europe ? N’est-ce pas d’ici que partent en masse, chaque jour, le drame, le roman, la poésie, le conte, la comédie, et tout ce que nous seuls avons su faire ? Depuis Clément Marot et Montaigne seulement, ne sommes-nous pas les bien-venus à donner à nos voisins les plus proches et les plus reculés, les plus excellents chefs-d’œuvre ? Eh quoi ! nous leur avons donné, jusqu’à présent, et pour rien, pour leur admiration et pour leur louange unanime, les tragédies de Corneille, les tragédies de Racine, les comédies de Molière, les fables de La Fontaine, les œuvres de Bossuet, nous leur avons donné les Contes de Voltaire, l’Esprit des Lois, l’Héloïse, l’Émile, tout le dernier siècle, et avec ce dernier siècle un peu de liberté, et maintenant, quand nous sommes à bout de ces rares, excellens et inimitables présens, nous irions disputer à ces nations comblées de nos bienfaits, quoi donc, je vous prie ? Les comédies de M. Scribe, les tragédies de M. Delavigne, les contes de M. de Balzac, tous nos puérils et faciles chefs-d’œuvre de vingt-quatre heures, nos vers efflanqués, notre prose essoufflée, tous les rebuts d’une imagination fatiguée d’inventer et de produire ? Certes ce serait là manquer non seulement de générosité, mais ce serait là manquer d’esprit. Certes, ce serait là vouloir devenir un sujet de risée dans l’histoire à venir. Voilà ! dirait-on en montrant les trois plus grands siècles de notre littérature, voilà ce que les Français nous ont donné généreusement, sans nous rien demander en échange que d’accepter leurs bienfaits à genoux ; puis, en même temps, à côté de cet admirable entassement de toutes les connaissances humaines, on poserait je ne sais quel fouillis sans consistance, et l’on ajouterait : — Et voilà ce que ces mêmes Français ont voulu nous faire payer bien cher ! Dérision, péché, folie ! Vous donnez pour rien votre gloire, vous voulez vendre votre néant !
La discussion une fois lancée ne s’arrêta plus. »
[Quatre autres orateurs argumentent le même point de vue contre l’instauration d’une loi réprimant la contrefaçon. Nous coupons ce passage interminable qui ne concerne pas Nerval.]
« Dans cette dissertation à brûle-pourpoint, notre ami, sans y prendre part, se contentait d’interrompre de temps à autre et de réclamer vivement en faveur des droits de l’écrivain. Il nous traita de barbares et d’incrédules, et se moqua de nous tous le plus agréablement du monde en nous disant, ce qui était vrai, que nous avions bien nos raisons pour ne pas vouloir être immortels ; que même, pour rien, les livres que nous faisions étaient trop chers, et que véritablement nous ne courions aucun risque à les laisser exposés à la contrefaçon française et étrangère. Avec cette chaleur de cœur qui ne l’a pas quitté, et ce bon sens qui le devait quitter si tôt, il nous cita plusieurs œuvres excellentes dans la littérature de ce temps-ci ; il nous demanda pourquoi donc aujourd’hui, quand un écrivain s’était fait célèbre dans les lettres, il abandonnait ses chères occupations de chaque jour pour devenir un homme politique ? C’est que, ajoutait-il, dans le monde politique, un homme se fait une fortune ; il jette les fondemens d’un avenir ; pendant que, dans votre mauvais monde littéraire, vous et moi, et nous tous, nous vivons au hasard ; nous dépensons notre esprit comme il nous vient, heure par heure, jour par jour, trop heureux et trop fiers si nos plus beaux ouvrages vivent une heure le jour de demain. Donc, mes maîtres, et il s’animait en parlant, ne vous opposez pas à ce que l’on cherche quelque moyen de donner un semblant de durée à vos œuvres ; j’avoue que cinquante ans c’est beaucoup pour vous, mais enfin ce n’est pas trop pour le public. Cinquante ans, cela fait bien dans une loi ; et, à tout prendre, quand vous mourrez, vous ne serez pas fâché d’avoir cinquante ans devant vous.
Il nous quitta assez mécontent, mais toujours plein de bienveillance et de bonté. Il se promena tout le jour, regardant toutes choses à sa manière, et suivant à la piste les tableaux et les statues de l’exposition nouvelle, leur souhaitant tout bas bonne chance, et ne se doutant pas qu’il usurpait ainsi le droit d’auteur des sculpteurs et des peintres de cette année. Le soir venu il s’en fut dîner avec ses amis, et ceux-ci ne remarquèrent rien d’étrange, sinon que leur convive était plus gai et plus grand parleur que de coutume. Du reste, sa gaîté était toujours affable et bonne ; il ne s’occupait qu’à combler ses amis de bienfaits imaginaires. Le repas fini, il partit en disant qu’il allait se diriger tout droit vers l’Orient, à l’endroit d’où vient le jour, et ce mot-là fut pris pour une de ses boutades accoutumées. C’était en effet son habitude de partir de temps à autre tout droit devant lui, sans même s’inquiéter de quel côté venait le vent. — C’était un soir de carnaval, le carnaval finissait. Ces horribles boutiques remplies de danses, de mascarades et de folies de tout genre, allaient s’ouvrir ; les pères de famille rentraient chez eux, les fous allaient à la fête ; dans cette hâte générale, le peuple est ainsi fait qu’il marcherait sur le corps de son père pour aller plus vite. A cette heure de désordre, chaque rue de Paris est la rue Scélérate, rien n’arrête ceux qu’appelle le bal masqué : chacun pour soi et le gendarme pour tous. — Gérard allait seul en chantant on ne sait quelle poésie mystérieuse. L’aspect de ces gens qui n’avaient ni leur habit ni leur visage de chaque jour le frappa d’épouvante, et il ne comprenait plus rien à ce qui se passait autour de lui. — Alors, pour être comme les autres, il jeta son chapeau à un pauvre qui lui tendait le sien ; — après le chapeau ce fut l’habit. — On le prit pour un masque qui allait au bal. Hélas ! hélas ! c’était le plus charmant esprit de ce temps ci qui allait aux Petites-Maisons.
Dans ces jours abominables de la folie des jours gras tout se dénature, et même le corps-de-garde. Le soldat sous les armes est inquiet, mal à l’aise, et à force de tout surveiller il n’a plus guère de vue distincte. — Notre pauvre enfant allait toujours, laissant à chaque pas un de ses vêtemens, un lambeau de sa raison. — Il était presque à demi-nu lorsqu’on lui cria : — Qui vive ? — Que pouvait-il répondre ? sinon : — C’est un poète qui passe, c’est un malheureux jeune homme qui s’est égaré et qui est seul ! c’est un enfant qui redemande son père et ses frères et ses amis de chaque jour ! — Comme il ne répondait pas, allant toujours tout droit devant lui vers cet Orient inconnu qui attire à soi les hommes d’élite depuis tantôt deux mille ans, le garde le saisit, non pas au collet, mais à la gorge, en disant toujours : — Où vas-tu ? — Lui alors, se sentant arrêté, et pour la première fois de sa vie trouvant un obstacle à sa rêverie du soir, il voulut se défendre. — Il se défendit comme un héros, on s’empara de lui comme d’un malfaiteur ! Il fallut le porter dans sa prison. — Que dis-je, prison ? Dans un trou, dans ce trou où le corps-de-garde jette les immondices vivantes que ramasse la patrouille. Quelle nuit ! quelle nuit pour lui qui était parti pour aller, Dieu sait où ! Alors il se mit à gémir, puis à souffrir tout bas ; — seulement il se rappela le nom de deux amis de ses beaux jours et il eut encore assez de présence d’esprit pour dire qu’on les appellât [sic]. — Ils furent appelés à dix heures du matin.
Ces deux amis c’étaient deux poètes, l’un fougueux, l’autres rêveur ; celui-ci tout passionné pour la forme extérieure, celui-là mélancolique et tendre ; l’un préoccupé de la beauté humaine à la façon de Rubens, l’autre plud porté vers les émotions timides et cachées. — Ils avaient vécu tous les trois longtemps sous le même toit, dans la même mansarde changée en palais, eux et Gérard. Vous jugez de leur trouble quand ils se virent réveillés en sursaut par un soldat ; mais jamais rien ne saurait donner une idée de leurs larmes, de leur désespoir, de leur épouvante, quand enfin, après bien des prières auprès du commissaire de police, ils purent aller tirer Gérard de son sépulcre. Ils l’appelaient par son nom ; ils lui baisaient les mains. — Écoute-nous, écoute-nous ! réponds-moi ! viens, viens, il fait un beau soleil ! Ils appelaient Dieu à leur secours, — et puis : Gérard ! Gérard ! Les soldats pleuraient et ils cherchaient dans un recoin de la prison le scélérat qu’ils croyaient avoir ramassé cette nuit-là. — Le pauvre enfant leur tendait les bras et il souriait..... au soleil !
Depuis ce jour, rien n’a reparu, ni l’âme, ni l’esprit, ni le cœur, ni pas une de ces charmantes qualités qui le faisaient tant aimer, – il ne sait plus ni son nom, ni le nom de ses amis, ni le nom adoré que tout homme porte là bien caché dans l’âme, — le sourire seul est resté.
Ah ! certes, la vie littéraire est dure, cruelle, difficile à porter jusqu’au bout de la journée, mais il faut avoir vu ces misères pour savoir quel est le serpent venimeux caché sous ces belles fleurs. Pauvre public, on ne vous dit pas tout ce qui se passe dans les entrailles de la poésie ! vous n’en avez ni les angoisses, ni les douleurs, ni les misères cachées, ni les tristes coups de foudre ; vous n’en avez que les beaux et splendides produits. Quand l’un tombe, les autres se serrent pour qu’on ne le voie pas tomber ; celui qui crie et se plaint, on étouffe ses cris par de plus grandes clameurs ; celui qui meurt à la peine, on l’enterre souvent sans éloge ; celui qui devient fou, on l’emporte en silence, et c’est un crime de le dire. Et pourquoi cependant, pourquoi tous ces mystères ? pourquoi ne sauriez-vous pas, de temps à autre, ô Athéniens ! ce qu’il en coûte pour obtenir votre suffrage ? Hélas, si vous saviez toutes les histoires lamentables, si vous pouviez voir de près les luttes de celui qui commence, les insultes et les mensonges qui attendent celui qui arrivent [sic], le désespoir et l’isolement de celui qui finit ! — Pauvres gens ! diriez-vous, et vous les prendriez tous en pitié.
Nous cependant qui tenons la plume et qui fournissons nuit et jour à cette affreuse dépense de l’esprit de chaque jour ; nous qui suivons en haletant tout ce qui est l’ordre et la révolte, la liberté ou l’esclavage, l’oisiveté ou le travail de ce siècle ; nous les conteurs frivoles, les amuseurs sérieux, les romanciers, les critiques, les poètes, que faisons-nous en présence de tant de malheurs inexorables ? Quelles leçons en avons-nous retirées ? Que nous a rapporté la mort de celui-là, tué en duel à vingt ans sans avoir embrassé sa mère ; la mort de celui-là que la fièvre a emporté comme il venait d’annoncer la révolution de Juillet en criant : — Malheureuse France, malheureux Roi ? La mort de celui-là tué par les balles des Suisses logés aux Tuileries ; la mort de celui-là tué d’une balle dans le bois de Vincennes, — orateur qui avait à peine dit son premier mot ; — que nous a rapporté la douce folie de ce poète, resté un poète, — et le délire de ce romancier surpris au plus fort de ses inventions ; et la folie de ce critique éperdu qui se figure que le monde est tombé sur lui pour l’écraser ; — et la fuite des uns, — et la ruine des autres ; — et les misères de ceux-là si riches hier, qui hier encore écrasaient de leur luxe les plus magnifiques, aujourd’hui sans habit et sans pain — et les longues captivités de tant d’autres — et ces deux-là qui se sont tués de leurs mains en cadençant leur dernière stance — et le malaise de tous — que nous rapportera enfin le malheur inexpliqué, inexplicable du meilleur, du plus aimable, du plus innocent d’entre nous ? — Dieu le sait ! mais il serait bien temps de ne pas nous briser ainsi les uns les autres ; il serait bien temps de nous porter à tous et à chacun compassion et respect ; il serait bien temps de descendre dans nos consciences, dans nos vanités, dans notre doute, dans notre isolement, dans notre orgueil, de nous interroger nous-mêmes et de savoir enfin d’où vient le mal ?
Ceci fait, nous pourrons alors nous occuper, en toute liberté d’esprit, de nos œuvres, de nos salaires, de notre gloire et de notre immortalité à venir. »
______